Vizea île de France
Vizea Sud-Est
Vizea Grand-Ouest
Vizea Sud-Ouest


Le secteur du logement social est aujourd’hui à un tournant stratégique. Responsable d’une part significative des émissions de gaz à effet de serre du secteur immobilier, il est à la fois fortement exposé aux enjeux climatiques et porteur de solutions à fort impact. Réaliser un Bilan Carbone n’est plus seulement un exercice réglementaire pour certains : c’est un outil de pilotage stratégique au service de la performance environnementale, économique et sociale.
Sur le plan réglementaire, le diagnostic d’émissions de gaz à effet de serre s’inscrit dans un cadre de plus en plus structurant : article L.229-25 du Code de l’environnement, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), décret tertiaire, RE2020, exigences croissantes des financeurs et des partenaires institutionnels. Pour certains bailleurs, il constitue une obligation ; pour tous, il devient un pré-requis de crédibilité.
Mais l’intérêt dépasse largement la conformité. Le Bilan Carbone permet avant tout de quantifier objectivement les émissions de GES liées à l’ensemble des activités du bailleur : fonctionnement interne, construction neuve, rénovation, exploitation du patrimoine, aménagement foncier. Cette vision globale met en lumière les postes réellement émetteurs, souvent sous-estimés ou mal appréhendés, comme les matériaux de construction, l’exploitation énergétique du parc ou encore les achats de services.
Cette photographie carbone constitue la base indispensable pour :
Enfin, dans un contexte de tension économique et énergétique, le Bilan Carbone devient un outil de résilience. Il permet d’anticiper les risques liés à la dépendance aux énergies fossiles, d’identifier des leviers de sobriété, et de sécuriser les trajectoires d’investissement à long terme, tout en améliorant le confort et la qualité de vie des locataires.
Si le Bilan Carbone® est un outil reconnu et largement diffusé, sa mise en œuvre dans le secteur du logement social reste hétérogène. Les constats de terrain sont clairs :
les périmètres diffèrent, les hypothèses varient, les méthodes de calcul ne sont pas toujours explicitées, et les résultats deviennent difficilement associables d’un bailleur à l’autre.
C’est précisément pour répondre à ces limites que Vizea a souhaité produire un livret blanc spécifiquement dédié aux bailleurs sociaux.
L’objectif premier est de créer un référentiel commun, partagé par les acteurs du secteur, permettant :
Ce livret blanc vise également à faciliter l’harmonisation des pratiques entre bailleurs, dans une dynamique de partage de bonnes pratiques, de montée en compétence collective et de coopération sectorielle.
Enfin, il s’agit d’un outil pédagogique. L’exercice du Bilan Carbone est parfois perçu comme complexe, chronophage ou trop technique. En structurant la démarche et en explicitant chaque étape, le livret blanc permet de démystifier l’exercice, de le rendre plus accessible aux équipes internes et de favoriser l’appropriation des résultats par les décideurs.
Le livret blanc a été conçu comme un outil opérationnel, directement mobilisable par les bailleurs sociaux et leurs partenaires. Sa rédaction s’appuie à la fois sur :
Le document est structuré autour de plusieurs axes clés. Il rappelle d’abord les fondamentaux méthodologiques du Bilan Carbone® : principes de calcul, facteurs d’émission, gestion des incertitudes, logique d’estimation. Cette étape est essentielle pour garantir la robustesse des résultats et leur bonne interprétation.
Il définit ensuite précisément le périmètre organisationnel d’un bailleur social, en tenant compte de la diversité des structures (siège, directions territoriales, filiales, équipements). Les activités sont clairement distinguées : fonctionnement, construction, rénovation, exploitation, aménagement foncier, autres activités spécifiques.
Le livret détaille également le périmètre opérationnel, en identifiant les postes d’émissions pertinents pour chaque activité, conformément aux six catégories réglementaires. Une attention particulière est portée aux activités immobilières, cœur de métier des bailleurs, avec des méthodologies adaptées à la construction neuve, à la rénovation et à l’exploitation du patrimoine.
Lorsque les données ne sont pas disponibles, le livret propose des hypothèses transparentes et justifiées, issues de référentiels reconnus ou de retours d’expérience consolidés. Les durées d’amortissement, les facteurs d’émission forfaitaires ou les valeurs par défaut sont explicités, afin de garantir la comparabilité et la reproductibilité des résultats.
Enfin, le livret met à disposition des tableaux de collecte de données, des indicateurs de restitution harmonisés et des clés de lecture pour exploiter efficacement les résultats du Bilan Carbone®.
Chez Vizea, nous sommes convaincus qu’un Bilan Carbone n’a de valeur que s’il débouche sur l’action. C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite pas à un exercice de comptabilité carbone, mais s’inscrit dans une démarche stratégique globale.
Nous accompagnons les bailleurs sociaux à chaque étape :
Notre expertise croise les enjeux carbone, énergétiques, réglementaires et patrimoniaux. Elle nous permet de proposer des plans d’actions concrets, intégrant à la fois la sobriété, l’efficacité énergétique, l’évolution des pratiques constructives, la rénovation du parc existant et l’adaptation au changement climatique.
Avec ce livret blanc, Vizea affirme sa volonté de structurer et fédérer le secteur du logement social autour d’une vision commune de la décarbonation.
Un outil au service des bailleurs, mais surtout au service d’un habitat plus sobre, plus résilient et plus durable.

Face à l’urbanisation croissante des territoires et à l’urgence climatique, la question de la mobilité occupe aujourd’hui une place centrale dans les réflexions sur la ville durable. Les déplacements quotidiens constituent en effet un enjeu majeur, à la fois environnemental, social et économique, tant ils influencent les émissions de gaz à effet de serre, l’accessibilité aux services et la qualité de vie des habitants. Dans ce contexte, la prise en compte des mobilités durables dès la conception des projets apparaît comme un levier essentiel pour accompagner la transition des villes vers des modèles plus sobres, inclusifs et résilients.
Les projets urbains, qu’ils soient menés à l’échelle d’un territoire métropolitain, d’une ville ou d’un quartier, jouent un rôle déterminant dans l’organisation des mobilités. À l’échelle territoriale, ils permettent de structurer les grands réseaux de transport et de penser les relations entre espaces urbains et périurbains. À l’échelle urbaine et opérationnelle, ils façonnent plus directement les pratiques quotidiennes de déplacement à travers la localisation des fonctions, la hiérarchisation des voiries ou encore la place accordée aux modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Pourtant, malgré cette influence déterminante, la mobilité reste souvent reléguée au second plan dans les projets d’aménagement.
Ainsi, la prise en compte insuffisante ou tardive des enjeux de mobilité dans les projets urbains soulève de nombreuses problématiques, allant de la dépendance automobile aux inégalités d’accès aux transports. Dès lors, il convient de s’interroger sur les limites des pratiques actuelles et sur les moyens de mieux intégrer la mobilité durable au cœur des projets urbains, afin de répondre aux défis contemporains et de construire des villes plus durables.
Malgré l’affirmation croissante des objectifs de transition écologique et de mobilité durable dans les politiques publiques, force est de constater que la mobilité demeure encore trop souvent intégrée de manière tardive ou partielle dans les projets urbains. Dans de nombreux cas, les choix d’aménagement sont d’abord guidés par des considérations foncières, programmatiques ou architecturales, reléguant les questions de déplacements à une phase ultérieure du projet. Cette approche séquentielle conduit à traiter la mobilité comme une contrainte technique à résoudre a posteriori, plutôt que comme un élément structurant du projet urbain.
Cette intégration tardive se traduit fréquemment par une inadéquation entre l’offre de mobilité et les usages générés par le projet. Les besoins en déplacements sont alors sous-estimés ou mal anticipés, entraînant des ajustements coûteux et parfois inefficaces, qu’il s’agisse de la création de voiries supplémentaires, du renforcement non planifié des transports collectifs ou de la gestion complexe du stationnement. En l’absence d’une réflexion globale dès les phases amont, la cohérence entre urbanisme et mobilité se trouve fragilisée, au détriment de la performance globale du projet.
Par ailleurs, de nombreux projets urbains restent marqués par une forte dépendance à la voiture individuelle. Héritée de modèles d’aménagement fonctionnels et zonés, cette dépendance se manifeste par une organisation spatiale génératrice de déplacements motorisés, une hiérarchisation viaire favorable à l’automobile et une place insuffisante accordée aux modes actifs et aux transports collectifs. Dans ce contexte, les infrastructures dédiées à la marche, au vélo ou à l’intermodalité apparaissent souvent discontinues, peu lisibles ou reléguées à des espaces résiduels, limitant leur attractivité et leur efficacité.
Les conséquences de cette prise en compte insuffisante de la mobilité sont multiples et soulèvent des enjeux majeurs. Sur le plan environnemental, elle contribue à une surutilisation de la voiture et donc au maintien de niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en contradiction avec les objectifs climatiques nationaux et locaux. Sur le plan social, elle renforce les inégalités d’accès à la mobilité, notamment pour les populations non motorisées ou vulnérables, en conditionnant l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements à la possession d’un véhicule individuel. Enfin, sur le plan urbain et économique, elle engendre des phénomènes de congestion, de nuisances et de perte de qualité des espaces publics, tout en générant des coûts importants liés aux adaptations tardives des infrastructures.
Ainsi, l’état des lieux met en évidence les limites d’une approche de la mobilité encore trop sectorielle et réactive dans les projets urbains. Ces constats soulignent la nécessité d’un changement de paradigme, visant à replacer la mobilité durable au cœur de la conception urbaine, comme un levier stratégique au service de la performance environnementale, sociale et fonctionnelle des territoires
Face aux limites mises en évidence par les pratiques actuelles, l’intégration effective de la mobilité durable dans les projets urbains suppose un changement profond des méthodes de conception et de pilotage des opérations d’aménagement. Il s’agit de dépasser une approche sectorielle pour inscrire la mobilité (pas uniquement voiture) comme un élément structurant du projet urbain, au même titre que le foncier, la programmation ou la qualité architecturale. Cette évolution implique d’intervenir dès les phases amont du projet, afin d’anticiper les besoins de déplacements et d’orienter les choix d’aménagement en cohérence avec les objectifs de durabilité.
L’une des conditions essentielles de cette intégration repose sur une articulation renforcée entre urbanisme et mobilité. La localisation des fonctions urbaines, la densité bâtie et la mixité des usages constituent des leviers majeurs pour réduire les besoins de déplacements motorisés et favoriser des pratiques de mobilité plus sobres. En ce sens, la conception de projets fondés sur la proximité et la compacité, souvent résumée par le principe de la « ville des courtes distances », permet de limiter la dépendance à la voiture individuelle tout en renforçant l’accessibilité aux services et aux équipements. Cette approche nécessite une coordination étroite entre les acteurs de l’aménagement, de la planification urbaine et des transports. En effet, rien que l’implantation du projet a une forte influence. Il n’est malheureusement par rare de voir des piscines municipales, des nouveaux quartiers, des cinémas être complètement en périphérie, loin de toutes autres activités ou habitations. La voiture devient alors la seule possibilité. Dans ce genre de situation, un projet de piste cyclable très coûteux arrive souvent quelques années après alors que cela aurait pu être anticipé.
Par ailleurs, la hiérarchisation et le partage de l’espace public jouent un rôle déterminant dans la promotion des mobilités durables. La requalification des voiries en faveur des modes actifs et des transports collectifs, la continuité des réseaux cyclables et piétons, ainsi que la lisibilité des parcours constituent des facteurs clés de report modal. Ces choix doivent s’appuyer sur des analyses fines des flux de déplacements et des usages, intégrant les différentes temporalités et catégories d’usagers, afin de garantir la sécurité, le confort et l’attractivité des modes alternatifs à l’automobile.
En outre, la place de la voiture individuelle doit être maitrisée dès la conception du projet. Il est possible de limiter son espace et son utilisation et développant des offres de solutions plus durables (transport en commun, vélo, marche autopartage, …). Ces programmes sont conséquents et mettent plusieurs années à sortir de terre, dès sa conception une réduction de l’usage de la voiture doit être anticiper en incitant et en favorisant de nouveaux usages. Ces actions permettront de rééquilibrer les modes mais aussi de limiter le stationnement dans ces nouveaux projets. Un choc d’offres de solutions durables de mobilité ne peut pas s’opérer sans contraindre et limiter la place de la voiture individuelle dans ces projets.
Les outils de planification et d’ingénierie de la mobilité représentent également des leviers essentiels pour une meilleure intégration dans les projets urbains. Les études de trafic multimodales, les modélisations de déplacements, ainsi que les documents de planification stratégique tels que les plans de mobilité ou les documents d’urbanisme, permettent d’objectiver les impacts des projets et d’orienter les choix d’aménagement. Toutefois, leur efficacité repose sur leur mobilisation en amont et sur leur capacité à nourrir réellement la conception du projet, plutôt que de servir de simples outils de validation réglementaire.
Enfin, l’intégration de la mobilité durable passe par une approche évolutive et adaptative des projets urbains. L’essor des mobilités partagées, des solutions de mobilité servicielle et des innovations numériques invite à concevoir des espaces capables d’évoluer dans le temps, en intégrant des marges de manœuvre pour de nouveaux usages. Cette flexibilité constitue un enjeu central pour garantir la résilience des projets face aux évolutions des comportements de mobilité et aux contraintes environnementales futures.
Ainsi, la prise en compte de la mobilité durable dans les projets urbains repose sur une combinaison de principes de conception, d’outils d’ingénierie et de pratiques opérationnelles. Elle nécessite une approche transversale et anticipatrice, permettant de faire de la mobilité non plus une contrainte, mais un véritable levier de performance et de durabilité des projets urbains.
Notre bureau d’études a été amené à réaliser des études permettant de favoriser l’intégration de la mobilité durable dans le processus d’aménagement d’un projet urbain, on peut citer parmi celles-ci :
Vizea est intervenu en tant qu’expert mobilité sur la 2eme phase de construction sur un quartier qui prévoyait la construction de 600 logements neufs sur la période 2022-2030. Cette étude s’est déclinée en trois phases : un diagnostic des mobilités et besoins associés comprenant un profil des usagers et des habitudes de déplacement, une analyse de l’offre de mobilité ainsi qu’une étude de l’évolution des flux liés à la construction de nouveaux logements.
Nous avons élaboré des scénarios intégrant une étude des solutions de mobilités durables et innovantes potentielle à mettre en place au sein du quartier Les scénarios sont complets et comprennent des hypothèses de reports de parts modales qui sont liés aux futurs besoins de stationnement. Ces hypothèses de parts modales et de ratio de stationnement pour les logements neufs dépendant des solutions d‘écomobilité qui pourraient être mises en place.
Enfin, nous avons réalisé une déclinaison opérationnelle du scénario choisi, avec un programme d’actions à mener l’échelle du quartier et si nécessaire de la commune, la recherche de subventions disponibles pour la mise en œuvre de celui-ci.
L’équipe a réalisé une analyse des comptages routier sur quatre points de comptages afin de caractériser le trafic de la zone d’activité et voir si celui-ci était compatible pour la requalification du boulevard vers une zone mixte comprenant plus de fonction résidentielle.
L’analyse des comptages s’est déclinée en étudiant les tranches horaires de fréquentation ainsi que les jours de fréquentation à l’échelle de la semaine. Également, les différentes localisations de comptages ont pu montrer les fluctuations de trafic en évaluant les entrées et sorties via les voies perpendiculaires ainsi que les rond points.
Une visite de terrain a été réalisée dans ce contexte permettant de diagnostiquer les enjeux pour les mobilités afin de réaliser des préconisations sur l’aménagement du Boulevard (discontinuité modes doux, trafic et nuisances observées, cadencement des transports en communs…).
À l’échelle française, d’autres projet sont des exemples d’intégration des enjeux de mobilités.
La desserte du quartier par le tramway, intégrée dès les premières phases du projet, a joué un rôle déterminant dans l’accessibilité du site et dans son attractivité. Parallèlement, le projet a accordé une place importante aux modes actifs, avec des espaces publics conçus pour favoriser les cheminements piétons et cyclables, ainsi qu’une gestion maîtrisée du stationnement. La hiérarchisation des voiries et la limitation des vitesses ont permis de réduire la circulation de transit et d’améliorer la qualité urbaine. L’intégration de la mobilité durable a ainsi contribué à accompagner la densification du quartier sans générer de congestion excessive, tout en renforçant son image de quartier innovant et durable.
L’analyse de la prise en compte de la mobilité durable dans les projets urbains met en évidence un constat clair : lorsque la mobilité est intégrée de manière tardive ou sectorielle, elle devient une contrainte technique génératrice de dysfonctionnements, de coûts supplémentaires et d’impacts négatifs sur l’environnement et la qualité de vie. À l’inverse, les projets qui placent la mobilité au cœur de leur conception démontrent que celle-ci constitue un levier structurant majeur de performance urbaine et territoriale.
Les exemples étudiés montrent que l’intégration réussie de la mobilité durable repose avant tout sur une anticipation des besoins de déplacements et sur une articulation étroite entre urbanisme et mobilité. La localisation des fonctions, la densité, la mixité des usages et la hiérarchisation de l’espace public apparaissent comme des déterminants essentiels des pratiques de déplacement. Lorsqu’ils sont pensés conjointement avec une offre de transports collectifs performante et des réseaux continus de mobilités actives, ces choix permettent de réduire durablement la dépendance à la voiture individuelle et de favoriser des comportements de mobilité plus sobres.
Au-delà des bénéfices environnementaux, la bonne intégration de la mobilité durable génère des répercussions positives à plusieurs niveaux. Elle améliore l’accessibilité des territoires, renforce l’équité sociale face aux déplacements, contribue à la qualité des espaces publics et soutient l’attractivité des projets urbains. Elle permet également d’accompagner la densification et le renouvellement urbain sans aggraver les phénomènes de congestion, en assurant une cohérence entre capacités d’accueil et capacités de déplacement.
Dans un contexte de transition écologique et de contraintes croissantes sur les ressources et l’espace, la mobilité durable ne peut plus être envisagée comme un simple volet technique des projets urbains. Elle doit être considérée comme un élément structurant du projet de territoire, mobilisant une ingénierie transversale et une vision de long terme. À ce titre, l’évolution des pratiques professionnelles, notamment dans les bureaux d’études et chez les maîtres d’ouvrage, constitue un enjeu central pour concevoir des projets urbains plus résilients, performants et adaptés aux défis contemporains.

L’évidence de l’usage du vélo pour les déplacements du quotidien à la campagne n’en est pas encore une et semble bloquée par de nombreux obstacles. Néanmoins, si l’on met à distance la binarité fallacieuse qui l’oppose à la voiture, il est facile de trouver les nombreuses raisons qui justifient le retour du vélo en milieu rural comme une réelle offre de mobilité5.
1. Les distances à parcourir ne justifient pas toujours l’utilisation de la voiture3 . « En 2020, les distances de moins de 5km représentent la moitié des déplacements en voiture4 » , soit une vingtaine de minutes de vélo mécanique sur terrain à faible dénivelé.
2. Le vélo est un moyen de déplacement financièrement plus avantageux que la voiture, ce qui ne permet pas forcément de la remplacer mais d’en réduire l’usage (et donc la consommation d’essence notamment), ou bien de se passer de la propriété d’un second véhicule. Un argument fort quand 15 millions de français sont en situation de précarité mobilité5 .
3. Le vélo et ses variantes permet aux personnes n’ayant pas accès à une voiture de se déplacer individuellement, y compris les enfants6 . C’est un vecteur de liberté et d’autonomisation.
4. Le recul de la sédentarité est un enjeu de santé publique7 ; le retour de la marche et du vélo comme modes prioritaires de déplacement sur les courtes distances est une réponse évidente et les modes actifs doivent être impérativement encouragés dans tous les contextes où cela est possible.
5. L’encouragement des alternatives à la voiture individuelle améliore considérablement le partage de l’espace public et contribue fortement à l’amélioration du cadre de vie, notamment en sécurisant les bourgs ou en évitant l’effet « parking8 » .
6. La pratique des modes actifs incite à réduire la distance des trajets et reconnecte l’usager avec son environnement, deux éléments très favorables à la revitalisation des bourgs et centre-bourgs, au soutien du commerce et des services locaux.
7. L’avantage environnemental du vélo sur la voiture lorsque cela est possible est évident, et sa pratique est nécessaire à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée dans sa Stratégie Nationale Bas Carbone9 ainsi qu’à la protection de la biodiversité.

Figure 1 : Centre-ville de Saint-Sauveur-en-Puisaye, occupé par un parking -Vizea, 2024
Il est donc primordial de rendre possible et sûr l’usage du vélo en milieu rural. Mais là où la densité des villes et métropoles offre un tissu idéal pour la mise en place d’un réseau cyclable, les faibles densités des campagnes et périphéries représentent un véritable challenge pour les collectivités et aménageurs. La modalité de réponse classique est la mise en place d’aménagements cyclables - en site propre ou non - souvent dans le cadre de schémas directeurs et plans de mobilité à différentes échelles. Ces aménagements sont absolument essentiels dans les bourgs, y compris peu ou très peu denses, et sur des axes stratégiques, mais ont leurs limites.
D’une part, il est très souvent financièrement irréalisable d’aménager un réseau cyclable intercommunal étendu, entièrement sécurisé et continu, d’autant plus dans un contexte de baisse voire disparition des subventions en faveur du vélo10 et d’affaiblissement des capacités d’auto-financement des collectivités locales1112 . En effet, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en bordure de départementale et séparée de la voirie peut coûter près de 400€ du mètre linéaire (sans acquisition foncière, sans éclairage). Les coûts de la réaffectation d’une route voire d’un chemin non revêtu comprenant le jalonnement, la signalisation verticale et horizontale et la sécurisation des traversées revient à environ 10 moins cher.
Quand bien même, la mise en place d’aménagements sur des itinéraires intercommunaux est parfois matériellement insuffisante pour assurer des bonnes conditions de circulation aux cyclistes. L’aménagement d’une piste cyclable séparée sur un itinéraire fréquenté par des véhicules motorisés plus ou moins lourds est une proposition de qualité, mais ne saurait convaincre les usagers les plus réticents ou vulnérables. Le bruit et la pollution ainsi que la proximité immédiate de véhicules circulant à grande vitesse restent des éléments très dissuasifs à la pratique des modes actifs. L’apaisement des voies sur lesquelles les cyclistes seront amenés à circuler se présente donc comme une nécessité.

Figure 2 : Piste bidirectionnelle en bordure de départementale (Ille et Vélo, CD35), Vizea 2024
De surcroît, un réseau constitué d’aménagements « classiques » comme des pistes ou bandes cyclables est vulnérable aux ruptures de continuité, puisque seules les portions proposant ces aménagements seront considérées comme « traitées ». Les ruptures sont tout à fait résorbables en milieu dense mais posent une réelle difficulté en milieu rural, sur des itinéraires intercommunaux très divers et sur des linéaires importants ; d’où l’importance d’une solution facile et peu coûteuse à mettre en place sur un linéaire étendu et continu.
De plus, plusieurs années s’écoulent entre la validation d’un aménagement lourd dans un schéma et sa mise en service. L’élaboration d’un réseau basé autant que possible sur la réaffectation de routes praticables vient compresser ces délais. Cela est d’autant plus faisable que la réaffectation se prête bien à l’expérimentation ; celle-ci permet une approche pédagogique mais aussi un véritable test de l’aménagement avant une éventuelle pérennisation.
D’autre part, chaque nouvelle artificialisation ou imperméabilisation de sols en milieu rural peut poser des difficultés environnementales ou règlementaires pour les collectivités. Attention, la création d’aménagement cyclable dans un contexte d’encouragement des modes actifs plutôt que la voiture individuelle est toujours un élément positif pour l’environnement ; le solde final est positif, en émissions de GES et en protection de la biodiversité. Cependant, il est important de noter que l’évitement d’artificialisation supplémentaire est toujours très positif.
Enfin, lorsque les modes actifs sont cantonnés à de faibles linéaires ou espaces peu étendus qui leur sont réservés, des tensions émergent13 . Une piste cyclable trop étroite, une voie verte très fréquentée par des modes divers, des espaces mixtes piétons-cyclistes sont autant de potentiels de tensions, conflits, voire incivilités entre les usagers, alors même que la place prise par la circulation automobile n’est, elle, que très peu contrainte et majoritaire dans la répartition de l’espace public14 . L’exemple est particulièrement parlant sur les voies vertes : ces linéaires dédiés aux mobilités douces doivent permettre la cohabitation des vélotafeurs et cyclistes utilitaires, des promeneurs, des enfants, des cavaliers… Cette situation est source de difficultés, au point que la DREAL Normandie a sollicité Vizea pour aboutir à des préconisations techniques en faveur de la cohabitation des cyclistes et cavaliers sur les voies vertes15 .
Ainsi, peut-être que la solution alternative en faveur des modes actifs serait d’abaisser la pression sur ces linéaires très convoités en ouvrant le reste de la voirie française aux usagers autres que les voitures et les poids lourds.
La réaffectation de la voirie, ou requalification, est l’évolution de la répartition de ses usages. Concrètement, il s’agit de transformer les axes à faible trafic - ou répondant à un certain nombre de critères comme la vitesse moyenne estimée, la largeur de la voirie etc– en des axes favorables à la pratique du vélo et des modes actifs, sur lesquels ils deviennent prioritaires ou seuls usagers. Le trafic motorisé doit ainsi être apaisé et redirigé vers d’autres axes.
Depuis 2023, Vizea a mené deux études de recherches traitant ce sujet pour faire émerger la mobilité de demain : Le « Système Alternatif de Mobilité » (SAM) avec Forum Vies Mobiles16 et « Partage de la route : la méthode FNH pour développer le vélo ! » avec la Fondation pour la Nature et l’Homme17 .
Le SAM propose un nouveau modèle systémique de mobilité à l’échelle nationale, pensant de manière cohérente les réseaux modes actifs en zones urbanisés et intercomunales et les réseaux de transport en commun ferrés et routiers. Une des mesures proposées repose sur la réaffectation de voiries peu fréquentées par les véhicules motorisés et de chemins ruraux en dernier recours au profit du cycliste, qui y devient le seul usager autorisé sauf ayants droit spécifiques. La réaffectation totale de départementales peu fréquentées s’articule autour d’un réseau primaire de pistes bidirectionnelles et surtout en complémentarité d’aménagements poussés en zones urbanisées. Le SAM propose un choc d’offre très important en zones rurales ou peu denses, en particulier concernant les transports en commun routiers ; en parallèle, il se permet donc de contraindre la voiture individuelle. C’est cela qui permet notamment l’utilisation exclusive par les modes actifs d’un linéaire important de voiries départementales.
L’étude FNH est elle totalement dédiée au sujet de la réaffectation. Elle propose d’abord un benchmark de la réaffectation, en France et à l’étranger, puis l’analyse du potentiel de réaffectation. Pour ce faire, Vizea a étudié précisément trois territoires pilotes, ruraux et périurbains. Un diagnostic des territoires puis une sélection des voiries éligibles à la réaffectation ont été effectués, par l’établissement de critères hiérarchisés et un travail SIG poussé. Puis Vizea a dessiné un réseau entier, basé sur la réaffectation des voiries automobiles mais aussi sur la mise en enrobé des chemins pour ne pas réaffecter des voiries à plus de 60 km/h. Le réseau est donc basé sur la réaffectation mais composé de mesures complémentaires. Enfin, le coût de la mise en place de réseaux similaires en milieu rural à l’échelle nationale a pu être estimé. Le modèle proposé par cette étude part de la réaffectation des voies à faible trafic et des chemins ; le reste s’est construit autour.
Les deux études sont complémentaires pour les territoires qui veulent s’engager dans cette démarche. Elles n’utilisent pas les mêmes procédés méthodologiques et permettent d’offrir des outils divers aux territoires. La réaffectation peut prendre plusieurs formes et s’adapter à chaque territoire en fonction de ses besoins et ambitions.
Tout d’abord la France dispose de plus 3 millions de km de routes et chemins, dont un peu plus de 2 millions sont estimés éligibles à la réaffectation selon l’étude de la FNH. Ce réseau très dense est une opportunité formidable pour l’accroissement des mobilités actives. En mettant en place la réaffectation dès que possible, il suffirait d’en aménager 3.5% pour aboutir à un maillage satisfaisant en milieu rural. Sur la totalité du réseau routier, seul 1.8% serait purement concerné par la réaffectation partielle ou totale. Vizea souligne en effet qu’en complémentarité de la réaffectation, les mesures d’apaisement des bourgs, des traversées de routes et autres aménagements appelés « classiques » dans cet article restent indispensables à la constitution d’un réseau continu et cohérent.
Ces itinéraires sont de grande qualité18 du point de vue des cyclistes car le revêtement enrobé est idéal pour la pratique du vélo, du rollers ou d’autres EDPM. Cela peut permettre d’éliminer le dilemme autour du revêtement qui concerne notamment les voies vertes (voir l’étude de Vizea pour la DREAL), en redirigeant les usagers qui cherchent un revêtement lisse vers les voies réaffectées et les autres sur les voies vertes et chemins non enrobés par exemple. Ces voies réaffectées en enrobé peuvent tout de même être rendues accessibles aux piétons et cavaliers bien qu’elles ne constituent sûrement pas l’offre la plus attractive pour ces usages. L’augmentation du linéaire et de l’espace disponible pour la pratique du vélo et des modes actifs ne peut être que favorable à la baisse des situations de tensions et conflits entre usagers. La réaffectation des voiries faiblement fréquentées présente également l’avantage d’offrir une largeur idéale pour la circulation confortable des cyclistes. De plus, la qualité paysagère des itinéraires est en moyenne très bonne puisque les petites routes de campagne ou les chemins traversent champs, forêts et montagnes. L’attractivité des itinéraires et trajets est un facteur à ne pas sous-estimer pour le report modal. L’expérience usager est absolument déterminante dans le choix du mode de déplacement et ce particulièrement lorsque l’on est à vélo, directement exposé aux éléments et connecté à son environnement direct.
Puisque la création de linéaire est limitée, les coûts de mise en place sont plus faibles que le coût de la mise en place d’un réseau équivalent en aménagements classiques. Vizea estime ainsi que la mise en place d’un réseau cyclable en milieu rural principalement basé sur la réaffectation de la voirie coûterait entre 12 et 18 milliards d’euros à l’échelle nationale selon le niveau d’ambition visé (étude FNH). Cette somme reste cinq fois moins élevée que la mise en place d’un réseau comparable avec des pistes cyclables. L’approche de l’étude SAM (Forum Vies Mobiles) aboutissait à des coûts encore inférieurs, environ 6 milliards d’euros, mais ce budget ne comprenait pas l’aménagement des zones urbanisées contrairement à l’étude de la FNH et surtout reposait sur la complémentarité avec un réseau principal constitué d’aménagements en site propre beaucoup plus coûteux. Ces deux études traitant de la réaffectation des voies proposent deux modèles désirables et innovants mais différents.
Si l’amélioration des conditions de circulations des modes actifs est primordiale, l’utilisation des véhicules motorisés restera évidemment prégnante en zones rurales, il est donc important de les prendre en compte. En fonction de la réaffectation effectuée, le réseau accessible aux véhicules motorisés peut être plus ou moins impacté et l’automobiliste plus ou moins contraint. Cependant du fait de l’offre très importante du linéaire français ces impacts restent acceptables. Les détours occasionnés sont plus aisément absorbables par un véhicule motorisé, tandis qu’ils seraient très fortement ressentis par les usagers actifs au point d’en être dissuasifs. Cela permettra également une meilleure optimisation du réseau routier et donc un ciblage plus efficace des coûts d’entretien. De plus, les voiries réaffectées restent accessibles aux ayant droits dont les riverains, agriculteurs, véhicules d’urgence etc. La réaffectation cherche en particulier à apaiser la fréquentation des voies, la vitesse et la dangerosité en interdisant les trajets de transit qui doivent être cantonné aux axes prévus à cet effet. Rééquilibrer l’utilisation de l’espace public et donc des voies de circulation est un enjeu majeur de ces prochaines années pour limiter l’usage de la voiture.
La question de la cohabitation entre usagers doux et agriculteurs a fait partie de l’étude menée pour la DREAL19 à propos de la cohabitation sur les voies vertes ; il en ressort assez largement que la consultation en amont du projet des usagers concernés et en particulier des agriculteurs le cas échéant peut évacuer un grand nombre de problématiques. L’utilisation de la voirie par des cyclistes et des agriculteurs est tout à fait possible dans de bonnes conditions dès lors que chaque usager s’attend à la présence de l’autre et sait y réagir avec des bonnes pratiques de sécurité. La concertation et la sensibilisation est essentielle pour la mise en œuvre de ces projets.
Du point de vue environnemental, la réaffectation d’un axe permet l’aménagement d’un linéaire potentiellement important sans impacts supplémentaires sur la biodiversité et l’environnement. Contrairement à l’aménagement d’une voie verte par exemple, aucune phase de travaux ni nouvelle imperméabilisation n’est à prévoir. Au contraire, la voie réaffectée sera plus apaisée et plus favorable aux traversées de faune par exemple. Toutefois, l’utilisation des chemins et sentiers dans le réseau préconisé par l’étude FNH requiert elle des travaux de reprise du revêtement.
La réaffectation est donc une solution d’aménagement très prometteuse pour les territoires ruraux. De nombreux exemples existent déjà : les Quiet Lanes20 en Angleterre, les voies vertes pâles21 en Corrèze, les voies réaffectées dans la Communauté de Communes Erdre et Gesvres ou encore les routes départementales devenues voies vertes22 dans la Manche. La Communauté d’Agglomération d’Epinal est également en train de mettre en place la réaffectation de la voirie depuis 2019.
Dans le but de formaliser une méthodologie de mise en place de la réaffectation, Vizea a étudié en profondeur des territoires pilotes ruraux et périurbains. La première étape est la sélection des axes éligibles et intéressants pour le réseau cyclable, c’est-à-dire à faible trafic ou indispensables au réseau (en fonction des pôles générateurs de flux notamment). Pour les études avec Forum Vies Mobile et la FNH, Vizea a intégré les chemins et sentiers au réseau en prévoyant un coût de reprise de l’enrobé afin de les rendre praticables. Cette mise en place peut se découper en trois phases :
- Cette première étape est la réalisation d’un diagnostic de mobilité sur le territoire, obligatoire pour prendre en compte correctement les spécificités du territoire et intégrer correctement le réseau réaffecté aux schémas et plans locaux existants. Grâce à cela, la sélection des voiries éligibles à la réaffectation peut être faite. Dès la première phase, une concertation poussée des usagers doit être prévue ; il est primordial d’expliquer la démarche avec pédagogie, de prendre en compte les besoins de chacun et de s’adapter aux éventuels cas particuliers. Cela n’empêche aucunement le portage d’un projet ambitieux mais au contraire le facilitera.
- Ensuite, l’aménagement le plus adapté doit être choisi en fonction des circonstance précises de l’axe. Par exemple, il peut être décidé d’appliquer une réaffectation totale, une réaffectation avec filtre ou une mixité.
- Enfin, un travail d’adoption du réseau doit être mené sur le territoire : cela peut passer par des expérimentations pérennisées par la suite qui assurent une transition douce auprès des usagers, un plan de communication ou par de la concertation accrue. Des indicateurs de suivi doivent être mis en place pour permettre l’évaluation de ce réseau innovant. Vizea propose ainsi de décliner ce travail sur mesure sur les territoires ruraux afin d’offrir un réseau cyclable de qualité aux usagers, financièrement et techniquement abordable pour les collectivités.
La réaffectation est une approche très prometteuse de la mobilité cyclable dans les territoires ruraux, mais il est très important de rappeler que cette stratégie d’aménagement ne doit pas remplacer l’approche systémique de la mobilité durable et inclusive pour tous. Afin d’apporter des solutions viables en territoires rural, l’amélioration de la desserte géographique et temporelle en transports en commun est un impondérable sans lequel l’indépendance vis-à-vis de la voiture individuelle ne peut pas être réalisable. De plus, la création de pistes ou de chaucidous par exemple reste impérative dans les bourgs ou autres point névralgiques. Plus globalement, la transition du rapport à la mobilité et de l’aménagement de nos territoires est nécessaire à la construction d’un nouveau modèle plus durable et pérenne. Le SAM (Forum Vies Mobiles) cherche justement à proposer ce nouveau modèle à l’échelle nationale et faire évoluer le système de mobilité français.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] https://reseau-velo-marche.org/actualites/bilan-2024-de-la-frequentation-cyclable-en-france/
[3] Bien entendu, il est admis que ces constats ne valent que pour les personnes en capacité physique de se déplacer à vélo, Engins de Déplacements Personnels Motorisés, fauteuils électriques etc.
[4] https://www.cerema.fr/sites/default/files/inline-files/zoom5-emc2-voiture-janv25.pdf
[7] https://sport.cnrs.fr/les-risques-de-la-sedentarite-et-de-linactivite-physique-sur-la-sante/
[9] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
[10] https://www.fub.fr/presse/plf-2026-budget-velo-national-qui-deraille
[14] https://www.worldcarfree.net/resources/freesources/pour_en_finir.pdf
[16] https://forumviesmobiles.org/recherches/16425/systeme-alternatif-de-mobilite
[17] https://www.fnh.org/la-methode-fnh-pour-developper-le-velo/
[18] A noter que l’état des routes à faible trafic est loin d’être homogène. Cependant, une route enrobée dégradée reste bien plus praticable qu’un revêtement non enrobé comparablement dégradé.
[20] https://www.cerema.fr/fr/actualites/routes-tranquilles-experience-quiet-lanes-angleterre

En milieu urbain, deux phénomènes de chaleur occurrent principalement : la surchauffe urbaine diurne et l’effet d’îlot de chaleur urbain nocturne.
La surchauffe urbaine se manifeste en journée sous l’effet de l’absorption intense du rayonnement solaire par les surfaces minérales majoritaires en ville, telles que les chaussées, les trottoirs et les façades. Ces matériaux, caractérisés par un albédo généralement faible (notamment le bitume), absorbent une grande part du rayonnement incident et présentent une forte capacité de stockage thermique. Ce phénomène est renforcé par l’imperméabilisation des sols, la faible couverture végétale limitant l’évapotranspiration, la rareté des surfaces en eau et les apports de chaleur d’origine anthropique.
L’effet d’îlot de chaleur urbain correspond quant à lui à la persistance de températures élevées durant la nuit par rapport au milieu rural, résultant de la restitution progressive de la chaleur emmagasinée par les matériaux urbains au cours de la journée. Il est accentué par la densité et la morphologie du bâti, qui limitent la ventilation et le rafraîchissement nocturne, ainsi que par la continuité des émissions de chaleur liées aux usages urbains.
En plus d’être une gêne pour les habitants lors des fortes chaleurs estivales, il devient un risque à anticiper auquel la ville doit s’adapter, c’est-à-dire la combinaison entre un aléa (canicule) et un enjeu (santé des populations) tout en prenant en compte sa probabilité d’occurrence (récurrence en saison estivale).
La TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique), un référentiel national élaboré par Météo France et le Ministère de la Transition Ecologique, fournit des projections climatiques fiables à l’échelle de la France métropolitaine pour guider les politiques d’adaptation et la planification territoriale face au réchauffement climatique dans son rapport de consultation publique publié fin 2023 :
• Une poursuite marquée du réchauffement thermique, avec une hausse moyenne des températures en France métropolitaine par rapport à la période 1900-1930, dans le scénario tendanciel retenu pour l’adaptation.
• Une augmentation du nombre de jours de fortes vagues de chaleur : par rapport à la période de référence 1976-2005, le nombre annuel de jours où la température maximale dépasse 35 °C est projeté d’augmenter fortement.
• Des précipitations annuelles globalement stables, mais avec une redistribution saisonnière : la TRACC projette une légère augmentation des cumuls annuels mais une baisse des précipitations estivales par rapport à 1976-2005, reflétant des contrastes saisonniers plus marqués.
• Des conditions atmosphériques contribuant à l’aggravation des phénomènes de surchauffe urbaine et d’îlot de chaleur urbain, notamment la fréquence accrue de situations anticycloniques et de vents faibles, limitant la dispersion de la chaleur et rendant les vagues de chaleur plus persistantes et difficiles à supporter, en particulier en milieu urbain.
En conséquence, les impacts négatifs associés aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes sont appelés à s’intensifier à l’échelle nationale, avec des effets marqués sur les populations et les territoires : augmentation des risques sanitaires et de la surmortalité, baisse de la productivité, tensions accrues sur les ressources en eau et en énergie, saturation des équipements, ou encore vulnérabilité renforcée des espaces urbains.
Afin d’évaluer la contribution des aménagements à l’atténuation des phénomènes de chaleur en ville, Vizea accompagne les maîtrises d’ouvrage dans l’optimisation bioclimatique des projets urbains. Pour ce faire, des campagnes de mesures de température avant et après projet sont mises en place. Deux types de mesures sont réalisables :
Les caméras thermiques offrent une visualisation du comportement thermique d’éléments urbains à un instant t en mesurant leur température de surface. Ces données permettent d’appréhender les facteurs influençant la température de surface des éléments urbains, et ainsi de tirer des conclusions quant aux matériaux, à l’orientation, aux couleurs, aux types de mise en scène de l’eau, au type de végétation ou encore aux types d’aménagement favorables au confort bioclimatique des espaces extérieurs urbains.
Ces données sont collectées par des mesures directement sur le terrain. En considérant les évolutions du climat en faveur de phénomènes de chaleur accrus, une journée caniculaire est privilégiée pour les prises de vue.
Les conclusions tirées de cette campagne de mesure permettent d’orienter les choix d’aménagement en faveur de villes plus résilientes face aux canicules.

Visualisation par caméra thermique des températures sur l’espace public - Vizea
Dans le but d’appréhender le comportement thermique de site défini, des capteurs thermiques fixes sont placés durant toute la période estivale à des emplacements judicieusement choisis avec les maitrises d’ouvrage, tels que des espaces extérieurs requalifiés à forte affluence, ou encore des espaces voués à accueillir des aménagements de type « îlot de fraicheur ». Ces capteurs effectuent des mesures de température et d’hygrométrie à pas de temps rapproché afin d’évaluer de manière continue les conditions bioclimatiques réelles. L’analyse croisée des données sur plusieurs plages horaires, notamment diurne et nocturne, permet de caractériser de manière fine le comportement d’un site face aux phénomènes de surchauffe et d’îlot de chaleur urbains sur une période caniculaire judicieusement sélectionnée. Les données sont systématiquement confrontées à des références, tel qu’un point frais non soumis aux aménagements dans un parc densément planté, ou les données d’une station météo France sur la période étudiée.

Pose de capteurs fixes sur le territoire de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (93) – Vizea
Ces campagnes de mesure sont conduites à deux reprises : une fois avant le début des travaux d’aménagement, puis une fois les travaux finis, afin de quantifier précisément la contribution du projet à la réduction des phénomènes de chaleur en ville. Les sites sont ensuite reclassés par rapport à leur comportement initial en point chaud, point intermédiaire ou point frais. Réalisés en différents points du projet, une projection cartographique de la résilience bioclimatique des aménagements est alors visualisable.

Visualisation graphique des mesures des capteurs thermiques fixes sur une période caniculaire de 10 jours – Vizea

À l’approche des élections municipales de 2026, les enjeux environnementaux occupent une place croissante dans le débat public. Longtemps perçues comme des scrutins de proximité cantonnés à la gestion quotidienne, les élections locales sont désormais reconnues comme un levier majeur de la lutte contre le changement climatique. En France, les communes et intercommunalités concentrent une part importante des décisions qui influencent directement les émissions de gaz à effet de serre, qu’il s’agisse de l’aménagement urbain, des politiques de mobilité, de la gestion des bâtiments ou de la production d’énergie. Le maire, en tant que chef de l’exécutif municipal, se situe au cœur de cette transformation.
Regardons plus précisément sur certaines thématiques comment nous pouvons établir ces influences.
Le secteur du bâtiment représente l’un des principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale, en raison des besoins de chauffage, de climatisation et de l’ancienneté d’une grande partie du parc immobilier. Le maire dispose d’un pouvoir déterminant pour orienter la trajectoire de décarbonation des bâtiments, à commencer par le patrimoine communal. Les choix d’investissement réalisés durant un mandat (rénovation thermique des écoles, des équipements sportifs ou des bâtiments administratifs par exemple) ont des effets durables sur les consommations énergétiques et les émissions associées, souvent sur plusieurs décennies.
Au-delà du parc public, les décisions municipales influencent également la rénovation des logements privés. Par le biais des politiques d’urbanisme, des dispositifs d’accompagnement des ménages et de l’animation territoriale, les communes peuvent accélérer ou freiner la transition énergétique du parc résidentiel. Le maire joue aussi un rôle de facilitateur entre les acteurs locaux (bailleurs sociaux, copropriétés, artisans) et les dispositifs nationaux ou régionaux de financement. À l’échelle d’une ville, une stratégie ambitieuse de rénovation énergétique permet de réduire structurellement les émissions de GES tout en améliorant le confort des habitants et en luttant contre la précarité énergétique.
Un autre exemple d’influence est concrètement le choix et la préférence des maires pour certains projets de construction ou de rénovation de bâtiments. S’ils ne participent pas directement au dessin architectural des projets, les maires ont leur mot à dire sur les permis de construire déposés et ont clairement le pouvoir d’influencer un projet. Une des situations rencontrées à de multiples reprises au sein des missions de Vizea est de constater qu’un maire valide un projet sur le presque seul aspect esthétique d’un bâtiment, quand les projets concurrents auront une meilleure réponse environnementale. L’ensemble des critères ne sont pas tous jugé et la beauté relative d’une façade peut facilement l’emporter.
Le secteur des transports constitue l’un des premiers postes d’émissions de GES en milieu urbain. Dans ce domaine, les décisions municipales ont un impact particulièrement visible et rapide. Le maire dispose de leviers puissants pour orienter les pratiques de mobilité, notamment à travers l’aménagement de l’espace public. Le développement des mobilités actives, comme la marche et le vélo, dépend largement de la volonté politique locale de redistribuer l’espace urbain, de sécuriser les déplacements et de rendre ces alternatives attractives face à la voiture individuelle.
Les politiques de mobilité portées par les municipalités influencent également l’usage des transports en commun et la place de la voiture en ville. Les choix en matière de stationnement, de limitation de vitesse, de zones à faibles émissions ou de soutien aux transports collectifs façonnent les comportements quotidiens des habitants. À l’échelle d’un mandat, ces décisions peuvent entraîner une baisse significative des émissions liées aux déplacements, tout en améliorant la qualité de l’air et le cadre de vie. Les élections municipales de 2026 détermineront ainsi si les villes poursuivent ou non la transformation engagée ces dernières années vers des mobilités moins carbonées.
La gestion des déchets relève directement des compétences locales et constitue un levier important de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la limitation des déchets enfouis et la valorisation des matières. Les choix opérés par les maires en matière de collecte, de tri et de traitement influencent les émissions de méthane issues des décharges, ainsi que les émissions indirectes liées à la production de biens neufs.
En favorisant le tri à la source des biodéchets, le compostage et le développement des filières de réemploi, les municipalités contribuent à une logique d’économie circulaire qui réduit la pression sur les ressources naturelles et l’empreinte carbone des territoires. Les politiques d’achats publics responsables, également décidées au niveau local, peuvent amplifier cet effet en orientant la demande vers des produits durables et sobres en carbone. Là encore, l’orientation donnée par les équipes municipales élues en 2026 aura des conséquences durables sur les flux de matières et les émissions associées.
Les communes jouent un rôle croissant dans la transition énergétique, notamment par la gestion de leurs propres consommations et par le soutien au développement des énergies renouvelables locales. Le maire peut impulser le développement de projets photovoltaïques, de réseaux de chaleur ou de solutions de production d’énergie décarbonée en mobilisant le foncier communal et en facilitant les partenariats avec des acteurs publics ou citoyens.
La maîtrise de l’énergie passe également par l’optimisation des usages, notamment à travers la modernisation de l’éclairage public ou la gestion intelligente des bâtiments municipaux et bien sûr leur rénovation). Ces actions, parfois perçues comme techniques, ont pourtant un impact direct sur les émissions locales de gaz à effet de serre. En orientant les investissements vers des dispositions sobres et renouvelables, les maires élus en 2026 pourront réduire durablement la dépendance des villes aux énergies fossiles.
Enfin, les politiques environnementales municipales ne se limitent pas à la réduction directe des émissions. Le développement de la nature en ville, la renaturation des espaces urbains et l’adaptation au changement climatique constituent des axes complémentaires portés par les maires. En favorisant les espaces verts, les sols perméables et l’agriculture urbaine, les communes améliorent la résilience des territoires face aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes, tout en contribuant indirectement au stockage du carbone et à la sobriété énergétique.
La décarbonation d’un territoire ne se limite pas à une juxtaposition de projets sectoriels. Elle repose sur une vision stratégique, généralement formalisée dans des documents de planification climatique comme les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux, souvent pilotés à l’échelle intercommunale mais fortement influencés par les orientations des maires. Le maire contribue à définir les priorités, les objectifs de réduction des émissions et les arbitrages budgétaires qui traduisent les engagements climatiques en actions concrètes.
À travers ses compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement économique, le maire façonne la structure même de la ville. La densité urbaine, la localisation des activités, la place accordée aux espaces naturels ou aux zones commerciales périphériques ont des conséquences directes sur les déplacements, les consommations d’énergie et l’artificialisation des sols. Les choix opérés lors d’un mandat municipal peuvent ainsi inscrire une ville sur une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques nationaux ou, au contraire, renforcer des modèles urbains fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Les élections municipales de 2026 constituent un moment charnière pour l’avenir climatique de nos villes. Derrière des choix apparemment locaux se dessinent des trajectoires de long terme en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de qualité de vie et de résilience écologique. Le maire, par ses compétences transversales et sa capacité à orienter l’action publique locale, s’impose comme un acteur central de la transition écologique. A ce titre, le débat électoral de 2026 devra pleinement intégrer les enjeux climatiques, tant ils conditionnent l’avenir des territoires et de leurs habitants.

Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) et, plus largement, les schémas directeurs immobiliers (SDI / SDIE) sont nés de la volonté d’organiser la politique immobilière publique française autour d’un diagnostic partagé et d’une planification pluriannuelle. L’obligation d’élaborer un SPSI a été formalisée pour les opérateurs de l’État par une circulaire ministérielle diffusée en 2009 (pour donner suite à la réforme de la politique immobilière – Lien) et précisée/renouvelée par des instructions ultérieures (notamment une circulaire de 2016 - Lien). Ces textes demandent un diagnostic précis du parc, une stratégie quinquennale et une cohérence avec la politique immobilière de l’État.
Qu’est-ce que cela recouvre concrètement ?
• Le SPSI pour schéma pluriannuel de stratégie immobilière des opérateurs de l’Etat est un document stratégique, de portée quinquennale, qui formalise les orientations d’un opérateur (ministère, établissement public, université, etc.) pour optimiser l’usage, la maintenance, la rénovation, la valorisation ou la cession de ses actifs immobiliers. Il s’appuie sur un diagnostic exhaustif (état des lieux, coûts, contraintes fonctionnelles, performance énergétique, risques, etc.) et définit un plan d’actions priorisé.
• Le terme Schéma Directeur Immobilier (SDI) est plus générique ; on le retrouve dans les collectivités et les entreprises (SDI, SDIR pour « régional » côté État) et il désigne le même type d’outil : planifier l’évolution du parc à court/moyen/long terme pour atteindre des objectifs fonctionnels, financiers et environnementaux.
La Direction de l’Immobilier de l’État (DIE) pilote la politique immobilière de l’État au niveau interministériel : elle fournit méthodes, cadres (SDIR, SPSI), outils et référentiels, et elle accompagne/valide les démarches des opérateurs étatiques. Autrement dit, pour les acteurs publics, la DIE est l’autorité de gouvernance et de coordination qui encadre l’élaboration et la mise en œuvre des SPSI/SDIR.
L’élaboration d’un SPSI a été imposée par la doctrine ministérielle (circulaires de 2009 et 2016), ainsi cet exercice s’adresse au secteur public/opérateurs de l’Etat. Les SPSI sont attendus des opérateurs et établissent la cohérence entre stratégie d’activité et patrimoine immobilier.
Les collectivités territoriales et entreprises privées ne sont pas soumis à la réalisation de cet exercice, mais le SDI / SDIE (schéma directeur immobilier énergétique) est largement promu comme une bonne pratique — en particulier pour répondre aux enjeux énergétiques, à la maîtrise des coûts, à la transformation des modes de travail et à l’accès aux financements publics ou subventions (projets de rénovation, performance énergétique, etc.).
Le Schéma Directeur Immobilier constitue un document stratégique interne qui permet à une organisation – publique ou privée – d’organiser la gestion de son patrimoine immobilier à moyen et long terme.
Il s’appuie généralement sur un diagnostic complet du parc, puis sur la définition d’une trajectoire immobilière cohérente avec les ambitions économiques, opérationnelles et environnementales de la structure.
1. Etat des lieux exhaustifs
La première étape consiste à constituer un état des lieux exhaustif.
On y retrouve généralement un inventaire précis des bâtiments, incluant :
- Typologie
- Superficie
- Année de construction
- Usages
- Niveaux d’occupation...
Cet état des lieux ne se limite pas à la dimension physique : il inclut également les données financières (coûts d’exploitation, loyers, coûts de maintenance) et énergétiques (consommations, émissions associées, conformité avec les obligations réglementaires). À cette étape, il est fréquent d’évaluer la vulnérabilité du patrimoine : vétusté, risques de non-conformité, obsolescence technique, ou inadéquation entre les espaces et les besoins actuels.
2. Analyse des données et identification des enjeux
La seconde étape du processus consiste à analyser ces données afin d’identifier les enjeux principaux. Cette analyse croise généralement plusieurs dimensions : performance énergétique, coûts d’exploitation, confort d’usage, adéquation fonctionnelle, opportunités foncières, risques de dégradation ou de suroccupation.
Cette phase permet de dégager une lecture claire des points critiques du parc immobilier et des potentiels leviers d’optimisation, qu’il s’agisse de rationaliser des mètres carrés, de rénover des bâtiments énergivores ou de repenser l’affectation des espaces.
3. Construction de scénarios d’évolution
Le SDI met en perspective différentes trajectoires possibles, chacune articulant rénovation, restructuration, cession ou valorisation d’actifs. Ces scénarios sont comparés en termes de coûts globaux, de gains énergétiques, de bénéfices opérationnels ou encore d’impact sur la qualité de vie au travail. Le rôle du SDI n’est pas de figer une décision, mais d’éclairer les choix en montrant les avantages et limites de chaque orientation.
4. Feuille de route opérationnelle
La dernière phase du schéma directeur consiste à produire une feuille de route opérationnelle. Celle-ci fixe une hiérarchisation des actions à mener, avec un phasage pluriannuel, des estimations financières et un plan de mise en œuvre. Le document final précise également les indicateurs de suivi qui permettront à l’entreprise de mesurer l’avancement et les bénéfices des actions engagées, notamment en matière de durabilité, d’économies d’énergie, de réduction des coûts ou d’amélioration de l’usage des espaces.
Le SDI est donc un outil d’aide à la décision, qui structure la stratégie immobilière autour d’une vision globale, objectivée et cohérente avec les priorités de la gouvernance.
Alors que le Schéma Directeur Immobilier (SDI) est un outil flexible, adapté à chaque organisation pour piloter son patrimoine à moyen et long terme, le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) répond à une logique plus encadrée et normée.
Le SPSI reprend de nombreux éléments du SDI (inventaire complet du parc, analyse des usages, évaluation de la performance et de la vulnérabilité des bâtiments) mais il se distingue par sa finalité normative et stratégique à l’échelle nationale. Là où le SDI peut être conçu pour répondre aux besoins propres de l’organisation et à ses priorités locales, le SPSI doit s’inscrire dans les objectifs globaux de la politique immobilière de l’État : rationalisation des surfaces, optimisation des coûts, performance énergétique, conformité réglementaire et adéquation avec les missions de service public.
La méthodologie du SPSI est donc similaire sur la forme (diagnostic, analyse des besoins, scénarios d’évolution, programmation pluriannuelle) mais avec une exigence de cohérence et de standardisation. Les informations doivent être compatibles avec les référentiels nationaux et utilisables pour la consolidation par la DIE, afin de permettre un pilotage comparatif entre opérateurs et une coordination globale des politiques immobilières.
Autre différence majeure : le SPSI s’accompagne systématiquement d’une programmation pluriannuelle chiffrée et priorisée, qui indique les actions prévues sur cinq ans ou plus, les arbitrages financiers, et les bénéfices attendus. Cette dimension pluriannuelle et normée est moins développée dans le SDI, qui peut rester davantage un outil d’orientation et de réflexion stratégique.
En résumé, le SPSI est à la fois un outil de planification interne et un document de reporting normalisé, conçu pour s’intégrer à la stratégie nationale et permettre à l’État de piloter de manière cohérente et harmonisée l’ensemble de son patrimoine.
Au-delà de la rationalisation du parc, SDI et SPSI deviennent aujourd’hui des outils essentiels pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la loi.
Ces outils constituent également un levier puissant pour réduire l’empreinte environnementale d’une organisation, qu’il s’agisse d’une entreprise privée ou d’un établissement public.
Lors de l’inventaire des bâtiments, on identifie leur consommation d’énergie, leurs émissions de gaz à effet de serre et leur conformité aux normes environnementales. Cette étape permet de mettre en lumière les bâtiments les plus énergivores, ceux nécessitant une rénovation thermique ou ceux qui pourraient être valorisés par des opérations de densification ou de mutualisation des espaces.
En France, la loi Climat et Résilience (2021) impose aux propriétaires publics et privés des obligations de réduction des consommations énergétiques, de rénovation des bâtiments classés F ou G, et de planification de travaux pour atteindre la neutralité carbone. L’élaboration d’un SDI ou SPSI permet donc d’intégrer ces obligations dès la planification stratégique.
La démarche stratégique qui suit (choix des scénarios de réhabilitation, de restructuration ou de cession) offre de nombreux bénéfices environnementaux. En rationalisant les surfaces occupées, en mutualisant les locaux et en optimisant l’usage des bâtiments, une organisation peut réduire sa consommation énergétique globale et limiter ses émissions de CO₂.
Un autre avantage réside dans la planification des rénovations et des travaux de mise en conformité environnementale. Le SDI ou SPSI permet d’intégrer dans un calendrier pluriannuel les interventions prioritaires pour atteindre des objectifs environnementaux mesurables, tels que l’installation de systèmes de chauffage moins carbonés, la rénovation de l’isolation, la modernisation des réseaux électriques, ou encore l’adaptation aux normes d’accessibilité et de qualité de l’air intérieur.
Un SDI ou SPSI ne se contente pas d’optimiser l’immobilier sur le plan fonctionnel ou financier. Il permet à l’organisation d’intégrer une véritable stratégie environnementale, en alignant la gestion du patrimoine avec les exigences légales, les objectifs de performance énergétique et de réduction des émissions, ainsi que les bonnes pratiques de développement durable.
Vizea place la transition écologique au cœur de l’élaboration d’un SDI ou d’un SPSI. Pour un opérateur public, un SPSI n’est pas seulement un outil de pilotage patrimonial : c’est une opportunité stratégique pour aligner les trajectoires immobilières avec les grandes exigences environnementales nationales.
À travers nos accompagnements, nous intégrons systématiquement l’ensemble des réglementations récentes pour construire une stratégie immobilière qui répond réellement aux ambitions environnementales fixées par l’État.
Le SPSI impose aux opérateurs de l’État de contribuer aux objectifs fixés par les politiques nationales, notamment :
• la Loi Climat et Résilience (2021), qui impose la baisse des consommations énergétiques du parc tertiaire, la rénovation progressive des bâtiments les plus énergivores et la trajectoire nationale de neutralité carbone
• le dispositif Éco Énergie Tertiaire (aussi appelé Décret Tertiaire), qui crée une obligation de réduction des consommations d’énergie finale à horizon 2030 / 2040 / 2050 ;
• la Stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC), qui guide la réduction des émissions du secteur immobilier ;
• la réglementation sur l’artificialisation des sols (ZAN – Zéro Artificialisation Nette), qui impose de limiter l’emprise foncière des nouvelles opérations et encourage la réhabilitation plutôt que la construction ;
• les plans nationaux d’adaptation au changement climatique, qui renforcent la nécessité d’anticiper les risques climatiques sur les bâtiments et les sites.
Notre rôle est d’aider l’opérateur à comprendre comment ces réglementations s’appliquent à son parc, quel niveau d’effort est requis et quels scénarios immobiliers permettent de s’y conformer durablement.
Chez Vizea, nous intégrons la transition écologique dès les premières étapes du diagnostic.
Cela se traduit par :
• Une analyse fine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments ;
• L’identification des « points noirs carbone » du parc (sites énergivores, passoires thermiques, bâtiments dispersés et coûteux à exploiter) ;
• Une évaluation de la vulnérabilité climatique des implantations (chaleur, sécheresse, tempêtes, risques naturels, surchauffe, etc) ;
• L’étude des consommations d’eau, des systèmes techniques et de leur durée de vie résiduelle.
Cette lecture environnementale permet ainsi de déterminer quelles implantations doivent être rénovées, consolidées, relocalisées ou cédées.
La finalité du SPSI est de fournir une feuille de route opérationnelle.
Dans cette phase, Vizea aide l’établissement public à :
• Prioriser les opérations à plus fort impact environnemental ;
• Planifier les investissements pour optimiser le rendement carbone–énergie ;
• Intégrer les aides, financements ou dispositifs incitatifs ;
• Etablir une trajectoire claire de conformité réglementaire sur plusieurs années ;
• Structurer une gouvernance interne capable de piloter la transition environnementale du parc.
Ainsi, la stratégie immobilière devient un levier de transformation environnementale : le SPSI fournit au dirigeant une vision claire, chiffrée et progressive de la transition énergétique et carbone de son patrimoine.

Initiée en 2015 par l’ADEME, le CDP et la World Benchmarking Alliance, l’initiative ACT — Accelerate Climate Transition® — répond à une nécessité : fournir aux organisations un outil méthodologique clair, sectorisé et opérationnel pour transformer des intentions en actions mesurables. Sa force : combiner vision stratégique et exigences de mise en œuvre pour garantir des trajectoires crédibles de décarbonation.
ACT Initiative se structure autour de trois dispositifs complémentaires permettant d’accompagner les entreprises selon leur niveau de maturité :
En articulant ambition climatique, transformation opérationnelle et pilotage de la performance, ACT fait de la transition bas-carbone un véritable levier de compétitivité et de pérennité pour les entreprises.
Au cœur de l’initiative, ACT Pas-à-Pas se distingue comme un véritable parcours de transformation : cinq étapes structurantes pour passer d’un diagnostic carbone à un plan de transition pilotable et aligné business.
Les étapes clés du parcours :

Cette méthodologie a été éprouvée par des dizaines d’organisations françaises. Les enseignements sont clairs : ACT Pas-à-Pas change la dynamique en profondeur et les bénéfices stratégiques sont immédiatement identifiés :
ACT Pas-à-Pas n’est donc pas un simple exercice théorique, mais un accélérateur stratégique : il met les entreprises en situation d’agir, de se différencier et de sécuriser leur place dans l’économie bas-carbone qui s’impose.
Selon une enquête réalisée par l’ADEME en 2025, 77% des entreprises ayant mis en œuvre ACT Pas-à-Pas jugent que l’impact global sur leur organisation est particulièrement positif, un signal fort du succès et de l’efficacité de la démarche.
À un moment où investisseurs, marchés, régulateurs et société civile exigent plus de transparence, d’ambition climatique et de responsabilité, notamment avec le déploiement de la CSRD en Europe, ACT Pas-à-Pas s’impose comme un levier stratégique majeur. Ainsi, ACT Pas-à-Pas se place comme un atout stratégique :
En définitive, engager la démarche ACT Pas-à-Pas, ce n’est pas seulement répondre à une exigence morale ou sociétale — c’est investir dans la résilience et la pérennité de l’entreprise, en lui donnant les moyens de naviguer avec succès dans l’économie bas-carbone.
Lancée il y a près d’une décennie, l’initiative ACT s’est imposée comme une boîte à outils sérieuse, crédible, reconnue pour accompagner les entreprises dans la transition bas-carbone. ACT Pas-à-Pas offre un cadre pour passer du diagnostic à l’action, sans se perdre dans la complexité, tout en gardant en ligne de mire l’ambition de l’Accord de Paris.
Pour les entreprises — qu’elles soient petites, moyennes ou grandes — c’est l’opportunité :
Le dispositif ACT Pas-à-Pas est subventionné par l’ADEME jusqu’à 70% selon la taille et le secteur de l’entreprise. Pour démarrer une démarche ACT Pas-à-Pas, il y a tout de même quelques prérequis :
Nos équipes sont formées et accréditées pour la démarche et peuvent répondre à vos questions.
Pour plus d’informations : Lien d'accès à ACT Initiative de l'ADEME

Aujourd’hui, le secteur du bâtiment est responsable d’environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre françaises (en considérant les consommations énergétiques des bâtiments et les travaux de construction ou de rénovation). Face aux objectifs de neutralité carbone que s’est fixée la France d’ici 2050 via la stratégie nationale bas carbone (SNBC), l’acte de construire et de rénover nos bâtiments doit évoluer pour mieux prendre en considération les efforts de réduction des émissions à réaliser.
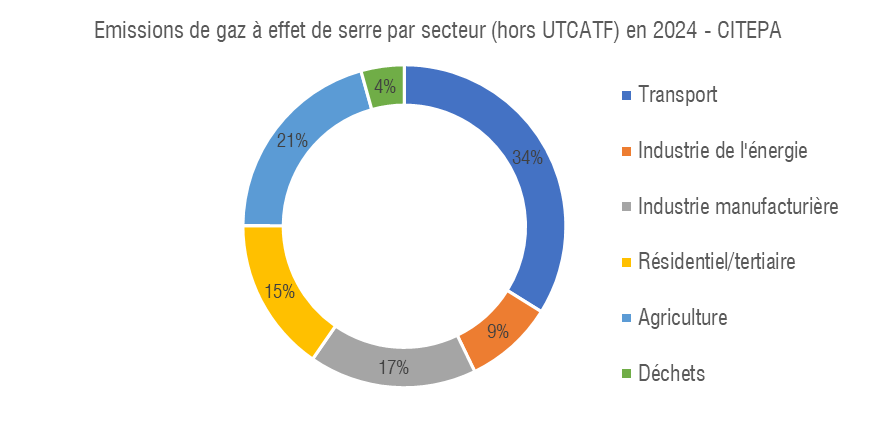
La construction neuve est réglementée par la RE2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et cadre notamment les émissions de GES d’un bâtiment sur sa phase de chantier et sa phase d’exploitation. Les seuils qui doivent être respectés évoluent jusqu’à 2031 de manière à ce que la filière du BTP puisse développer ses méthodes de construction bas carbone, ainsi que les filières de matériaux adaptées.
Sur le volet de la rénovation, il n’existe aujourd’hui aucune réglementation qui vient de manière similaire, évaluer les émissions de gaz à effet de serre des matériaux mis en œuvre, de leur renouvellement, des processus en phase chantier.
Alors finalement au-delà de la seule manière de construire et de rénover, un des leviers pour concrètement réduire les émissions de GES futures, est peut-être la réversibilité des bâtiments, pour mieux anticiper les travaux de modification et de transformation d’un bâtiment.
D’un point de vue des usages, alors que la durée de vie moyenne d’un bâtiment dépasse en général 50 ans, son usage, lui, change souvent au cours du temps (bureaux transformés en logements, commerces reconvertis en espaces de coworking ou ateliers). Ce sont tous ces changements qui entraînent des travaux et souvent une destruction partielle, générant des déchets, des consommations énergétiques et la mise en œuvre de matériaux neufs et donc des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.
Selon l’AQC, la réversibilité caractérise l’aptitude d’un ouvrage, neuf ou existant, à changer facilement d’usage plusieurs fois dans le temps. L’AQC dans son guide pour la réversibilité regarde quatre autres notions :
- La démontabilité : capacité d’un bâtiment à être démonté de façon non destructive, pour le déplacer ou pour restituer le site à son état d’origine
- L’évolutivité /modularité : capacité à la flexibilité et à l’élasticité afin de faciliter les changements d’affectation des espaces d’un bâtiment
- L’hybridation : réversibilité progressive du fait d’une liberté de l’espace, d’une indétermination des usages ou d’une programmation plurifonctionnelle au sein d’un même bâtiment
- La transformation : reconversion et restructuration lourdes avec changement de destination.
Ces différentes dimensions nous invitent à caractériser plus concrètement ce qu’il y a derrière la notion de réversibilité.
Les grands principes de la réversibilité incluent notamment :
- Une structure porteuse indépendante des cloisonnements pour permettre la redistribution des espaces, sans intervention lourde sur la structure
- Une hauteur sous plafond adaptée pour différents usages (exemple des hauteurs sous plafonds des logements ou des bureaux qui sont généralement différentes)
- Une trame constructive modulable (par exemple 7,20 m plutôt que 5,40 m pour accueillir des aménagements variés), dans laquelle une trame plus légère pourra également exister s’il y a un besoin de cloisonner davantage
- Des réseaux techniques accessibles et démontables, facilement remplaçables et clairement identifiés
- La mise en œuvre de matériaux de second œuvre facilement remplaçables et n’engendrant pas de dommages sur d’autres matériaux lors de leur dépose. Les poses mécaniques sont par exemple privilégiées aux poses collées pour les revêtements de sol.
- Des menuiseries extérieures dimensionnées et positionnées pour convenir à plusieurs usages
- Des systèmes techniques dimensionnés pour convenir) plusieurs usages
- Une conception liée au confort d’été adaptée à différentes plages d’usage
Si en tant que concepteur d’un bâtiment réversible nous mettons en œuvre ces principes, il serait alors intéressant de pourvoir mesurer les émissions de GES réellement évitées selon le cycle de vie du bâtiment et de pouvoir corréler par ordre d’importance les différents leviers. Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment sont décomposées les émissions d’un bâtiment moyen.
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que les émissions de GES engendrées par un bâtiment neuf (en lien avec les seuils de la RE2020) sur son cycle de vie sont réparties de la manière suivante :
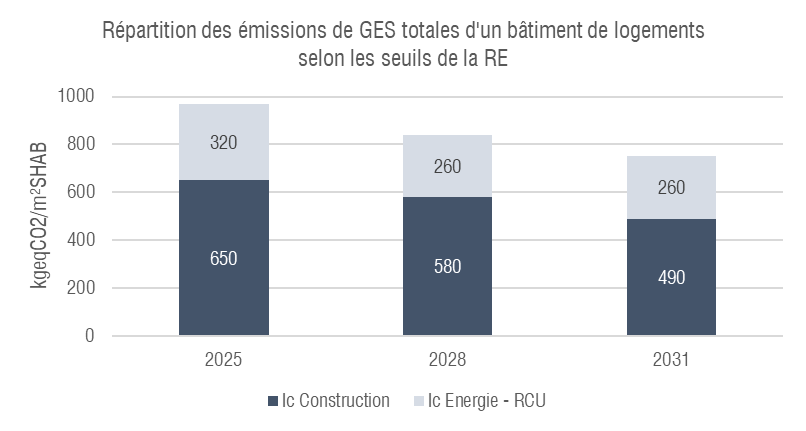
L’indicateur Ic Construction intègre les émissions liées à la mise en œuvre des produits de construction et l’indicateur Ic énergie intègre lui les émissions liées aux consommations énergétiques du bâtiment sur 50 ans. En moyenne, 67% des émissions d’un bâtiment sur 50 ans sont ainsi liées aux produits de construction (mise en œuvre, renouvellement et traitement en fin de vie) et 33% aux consommation énergétiques.
Dans ces 67% d’émissions, est comptabilisée la fin de vie des matériaux, au regard des analyses de cycle de vie propres à chaque matériau. Et en moyenne, il peut être considéré que 10% des émissions sont à relier à cette phase de fin de vie.
Nous avons donc vu que la construction et le renouvellement de certains produits de construction sont considérés dans l’impact carbone initial d’un bâtiment sur 50 ans, mais les travaux de rénovation lourde que celui-ci subit au bout de 30 ou 40 ans ne sont pas considérés. Ainsi, lorsqu’un bâtiment non réversible doit être démoli après 30 ans pour changer d’usage, il faut reconstruire, ce qui vient finalement grever le poids carbone global.
Essayons d’y voir plus clair à l’aide d’un cas pratique :
Pour un bâtiment tertiaire de 10 000 m² ayant une durée de vie cible de 50 ans, différents scénarios de réversibilité et d’impact carbone ont été modélisés. Il en ressort les éléments suivants :
Prenons l’exemple d’un bâtiment tertiaire de bureaux. Dans le cas le plus classique, la conception du bâtiment ne permettra pas une réelle réversibilité dans le temps. Des travaux de rénovation, qu’ils soient d’ordre énergétiques ou plus lourds seront réalisés au bout de 30 ans.
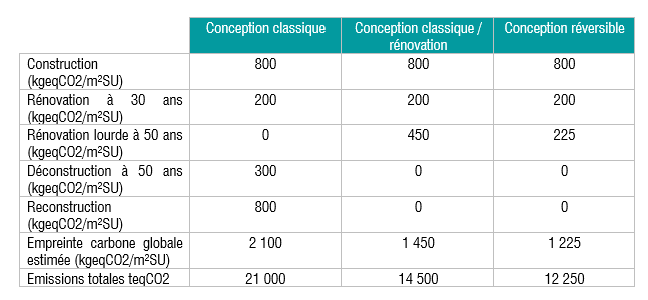
Ces valeurs estimées sont issues à la fois de la RE2020 pour la valeur seuil de construction d’un bâtiment de bureaux, et issus de retours d’expérience Vizea extrapolés pour les rénovations et déconstructions. Si ces valeurs peuvent être remises en question, il s’agit avant tout de comprendre les ordres de grandeurs et les enjeux qui se cachent derrière chaque nouvelle phase que subit un bâtiment.
Il est donc important de considérer que si tous les grands principes de la réversibilité sont mis en œuvre, l’ensemble des travaux de rénovation et de réallocation des espaces et de changement d’usage, seront davantage réduits dans le temps, voir divisés par 2 au global sur 50 ans.
A noter que cela suppose aussi que le changement d’usage ne soit pas non plus drastique, remettant en cause l’ensemble des systèmes techniques et de leur dimensionnement pour convenir aux nouveaux usages.
Concevoir des bâtiments réversibles, c’est passer d’une logique de cycle court à une logique de résilience. C’est aussi reconnaître qu’un bâtiment n’a pas une fonction figée : il vit, il évolue. En réduisant les démolitions et reconstructions, on économise des milliers de tonnes de CO₂, tout en répondant à la demande croissante de flexibilité immobilière.

Jules Drique a pris la tête de l’agence Vizea à Nantes avec une double conviction : l’envie personnelle de s’ancrer dans un territoire qu’il aime, et la certitude que le Grand Ouest est un laboratoire majeur de la transition écologique.
Portée par le principe de “collopement” de Vizea – qui encourage l’initiative et la prise de responsabilités des collaborateurs – l’ouverture de cette agence s’inscrit dans une dynamique forte : accompagner de près les collectivités, aménageurs et acteurs privés face aux défis du réchauffement climatique, de la ressource en eau, de la biodiversité et de l’aménagement sobre.
Dans cette interview, il revient sur son rôle de directeur d’agence, les enjeux environnementaux et urbains du territoire nantais, la manière dont Vizea Grand-Ouest se distingue dans ses missions, et la vision qu’il porte pour les prochaines années… jusqu’à un souhait “magique” pour la Loire et son bassin versant.

L’agence de Nantes de Vizea est née de mon envie personnelle de m’installer dans cette ville et de la confiance que m’ont accordé les associés historiques Jean-François et François-Xavier en application du concept interne de "Collopement" qui amène notre société à soutenir le développement personnel de ses salariés, en favorisant leur prise de responsabilités.
Au-delà de cette dynamique personnelle et de confiance, j’avais la conviction que Nantes et le Grand Ouest était un territoire où Vizea pouvait avoir un impact fort et que les collectivités et les acteurs portent de vraies ambitions de sobriété, de planification écologique et de résilience. Ouvrir une agence ici était l’occasion de renforcer la présence de Vizea dans le Grand Ouest et de construire une équipe pluridisciplinaire capable d’accompagner les acteurs locaux avec ambition, proximité et exigence technique.
En tant que directeur de l’agence de Nantes, j’occupe un rôle à la fois stratégique et opérationnel. Il combine plusieurs responsabilités :
Dans le Grand Ouest, je souhaite impulser une dynamique de présence renforcée auprès des acteurs publics et privés, avec l’ambition de devenir un interlocuteur incontournable sur les sujets de transition écologique, que ce soit à l’échelle du bâtiment, des opérations d’aménagement ou de la planification territoriale.
Mon objectif est aussi de continuer à structurer nos métiers – l'approche multi-échelle bas carbone, l'énergie, la, résilience climatique, l'écologie urbaine, pour maintenir un haut niveau d’expertise.
Je veux également consolider une dynamique collective forte : une agence où chacun progresse, se sent légitime, prend des responsabilités et trouve sa place dans un projet commun.
Sur le territoire nantais et plus largement dans le Grand Ouest, les enjeux sont très clairs : réchauffement accéléré, pression sur la ressource en eau et artificialisation encore trop forte.
Les travaux du GIEC des Pays de la Loire montrent déjà une hausse de +1,5 °C, des vagues de chaleur plus fréquentes et une situation hydrique très dégradée, avec seulement 11 % des masses d’eau en bon état et un risque important d’étiages sévères dans les prochaines décennies
À cela s’ajoutent la fragilité de la biodiversité locale, le recul des zones humides, et une forte exposition du littoral aux submersions et à l’érosion.
Dans un territoire aussi dynamique que le nôtre, le défi consiste à concilier attractivité, sobriété et résilience, en repensant nos manières d’aménager, de construire et d’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition.
Ces constats, Vizea les vit de manière très opérationnelle. Nous avons accompagné Nantes Métropole sur des démarches structurantes — l’évaluation à mi-parcours du Plan Local de l’Habitat (PLH), l’expertise pour faire évoluer le PLUi vers plus de densité maîtrisée et plus de nature en ville — mais aussi Rennes Métropole, notamment sur son PLH et sur l’application de son référentiel d’aménagement énergie & bas carbone.
Ces missions nous donnent une lecture fine des leviers concrets de la transition territoriale, et des arbitrages à mener pour transformer durablement les pratiques d’aménagement.
L’enjeu, aujourd’hui, c’est de permettre aux territoires de concilier attractivité, sobriété et résilience, et de faire en sorte que ces ambitions environnementales deviennent des actions concrètes à toutes les échelles.
Ce qui distingue l’agence Vizea Grand Ouest, c’est d’abord notre capacité à combiner vision stratégique et opérationnalité. Nous accompagnons aussi bien les collectivités dans leurs documents structurants — PCAET, SCOT, PLUi, PLH, référentiels d’aménagement — que les aménageurs et promoteurs dans le développement de leurs opérations.
Ensuite, nous sommes ancrés dans le territoire : les missions que nous avons menées autour de Nantes comme de Rennes nous donnent une connaissance fine des acteurs, des enjeux locaux, et des dynamiques propres au Grand Ouest.
Enfin, notre approche est résolument pluridisciplinaire et coopérative. On croise urbanisme durable, énergie, bas carbone, biodiversité, confort, eau, paysage… et on avance toujours en co-construction avec les acteurs locaux. Notre objectif est simple: transformer la transition écologique en solutions concrètes, adaptées au territoire et à ses projets.
J’imagine l’évolution de l’agence en plusieurs temps.
Les années 2026 et 2027 seront marquées par plusieurs échéances électorales, à l’échelle municipale comme nationale. Comme à chaque cycle politique, cela crée une période d’incertitude et de recalage des priorités, avec des pauses dans certains projets puis des ré-impulsions selon les nouvelles orientations. L’agence se prépare surtout à être adaptable, à l’écoute et capable d’accompagner les collectivités quel que soit le contexte.
Au-delà de ce moment de transition, l’agence a vocation à renforcer sa présence auprès des acteurs du territoire. Nous souhaitons monter en puissance sur les enjeux émergents : l’intégration de la santé dans l’aménagement, la vulnérabilité climatique, et la neutralité carbone. Ce sont des piliers qui vont structurer les politiques publiques dans les prochaines années.
Nous allons également continuer à développer notre maîtrise d’œuvre environnementale, du quartier au bâtiment, pour transformer les ambitions environnementales en solutions concrètes : hydrologie, biodiversité, bas carbone, confort d’été.
Enfin, je souhaite que l’agence poursuive son évolution en tant qu’acteur de référence du Grand Ouest sur l’accompagnement de la transition écologique. Nous avons déjà posé des bases solides avec Nantes et Rennes, et notre objectif est de continuer à structurer cette position, avec une équipe pluridisciplinaire, innovante et ancrée localement.
Si je pouvais transformer un lieu du Grand Ouest demain matin, ce serait le fleuve de la Loire pour lui offrir une reconnaissance institutionnelle et symbolique forte : faire en sorte qu’il soit considéré comme “personne juridique” — c’est-à-dire doté de droits.
L’idée peut sembler un peu utopique, mais elle a le mérite d’ouvrir un autre regard sur ce que représente la Loire : un être vivant, porteur d’une histoire, d’écosystèmes fragiles, d’une biodiversité remarquable, d’un corridor naturel, d’un patrimoine naturel et culturel, plus qu’une simple “ressource”. Elle s’inspire des démarches déjà initiées pour d’autres fleuves dans le monde et de réflexions qui émergent en France. Il s’agit de donner à la Loire le droit d’exister, de vivre, de se régénérer, de voir respectées ses dynamiques naturelles et son bassin versant, de défendre ses intérêts dans la durée.
Si demain la Loire avait des droits - le droit au maintien de la biodiversité, le droit à la continuité écologique, le droit d’être défendue - on serait amenés à repenser nos usages du fleuve : la gestion des eaux, les activités qui l’impactent, les projets situés dans son bassin versant… car toute atteinte avérée à son intégrité pourrait être contestée ou sanctionnée, comme si la Loire pouvait être représentée et défendre ses intérêts
Alors oui, si j’avais un vœu “magique” demain matin : offrir à la Loire la parole, la protection, la reconnaissance. Et faire de son bassin versant un territoire vivant, respecté, et capable de traverser les décennies en préservant ses milieux, ses paysages, sa biodiversité — pour les habitants, pour les générations futures, et pour le vivant tout entier.

Dans un contexte de raréfaction du foncier, d’exigences croissantes liées au Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et d’une forte demande en logements, les collectivités doivent repenser leurs modes de production urbaine. Les friches — industrielles, urbaines, artisanales, hospitalières, ferroviaires, commerciales ou encore rurales — représentent à ce titre un potentiel stratégique largement sous-mobilisé.
Pourquoi restent-elles inexploitées ? Quels leviers activer ? En quoi une approche systémique renouvelée apporte-t-elle un cadre indispensable d’analyse et d’action ? Et comment l’ingénierie environnementale et climatique peut-elle valoriser et sécuriser ces démarches ?
La requalification des friches s’impose désormais comme un pilier de l’urbanisme durable, du développement territorial et même de la cohésion sociale (Cerema, ORT, ANRU). C’est précisément l’expertise de Vizea : accompagner les territoires dans l’identification, l’activation et la transformation de ces gisements latents, grâce à une ingénierie amont solide, à la fois environnementale, stratégique et opérationnelle.
Il est important de distinguer clairement trois notions clés pour comprendre les enjeux liés aux friches et au foncier.
La friche désigne un espace bâti ou non bâti, délaissé ou sous-utilisé, issu d’une activité économique, publique ou privée qui a cessé ; elle peut être polluée, obsolète ou simplement vacante.
Le foncier, quant à lui, ne se limite pas au terrain : il englobe l’ensemble des droits qui y sont attachés — propriété, constructibilité, servitudes, usages — et ne devient véritablement mobilisable que lorsqu’il est maîtrisable sur les plans juridique, technique et stratégique.
Enfin, le renouvellement urbain correspond à un processus global de transformation des quartiers existants, combinant réhabilitation, requalification des espaces publics, diversification de l’habitat, mobilisation du foncier vacant, amélioration du bâti, arrivée de nouveaux services et développement des mobilités actives. Ensemble, ces trois concepts forment la colonne vertébrale des politiques locales de transformation des territoires.
La friche représente d’abord l’opportunité : un espace délaissé, sous-utilisé ou obsolète, qui ouvre la possibilité d’agir sans artificialiser davantage les sols.
Le foncier constitue ensuite un levier déterminant : au-delà de la seule maîtrise des droits qui lui sont attachés — propriété, usages, constructibilité — il porte aussi la mémoire des usages passés, des identités locales et des dynamiques sociales qui s’y sont succédé. L’appropriation de ce foncier, qu’il s’agisse d’un quartier tombé en désuétude ou d’un terrain en attente de projet, permet de rendre concrète toute ambition de transformation, en conditionnant sa faisabilité opérationnelle autant que son acceptabilité sociale.
Enfin, le renouvellement urbain en représente la finalité : Il s’agit non seulement de requalifier, diversifier, reconnecter et revitaliser des morceaux de ville ou de village, mais aussi de restaurer leur rôle social, d’y réintroduire une intensité de vie faite d’interactions, de services et de pratiques collectives, et de redonner sens à des lieux parfois oubliés. L’objectif est ainsi d’améliorer la qualité de vie, l’attractivité et le fonctionnement territorial, tout en renouant avec l’histoire et l’identité qui façonnent durablement ces espaces.
Dès lors, une question se pose : si ces démarches produisent autant de valeur, pourquoi ne pas les généraliser ? Comment identifier le gisement foncier et social mobilisable ? Quel processus mettre en place pour transformer durablement ces espaces, tout en anticipant les évolutions climatiques ? Et quel rôle l’ingénierie environnementale peut-elle jouer pour orchestrer ces transitions ?
Évaluer les gisements fonciers : un prérequis stratégique
Le Cerema, la ANCT et les EPF le rappellent : il n’y a pas de politique de requalification sans connaissance fine des gisements. Évaluer ces gisements, c’est :inventorier les friches et les terrains sous-utilisés ;
• inventorier les friches et les terrains sous-utilisés
• qualifier leur état (pollutions, sols, structures, risques) ;
• analyser les contraintes réglementaires (PLU, PPR, servitudes) ;
• prendre en compte les enjeux climatiques ;
• projeter les usages possibles ;
• mesurer l’ampleur des besoins en logements et équipements ;
• évaluer les potentiels et arbitrer entre densification, requalification, renaturation.
À ce jour, on dispose de pistes chiffrées fortes : selon l’inventaire national piloté par le Cerema, environ 15 000 friches ont été recensées en France, représentant un foncier cumulé d’environ 60 000 hectares .
D’autres sources estiment que la superficie potentielle des friches pourrait atteindre entre 90 000 et 150 000 hectares. Ce gisement est donc bien réel et immense. Par exemple, la plateforme “Cartofriches” du Cerema recense plus de 14 300 sites à ce jour.
Par ailleurs, les dispositifs publics se sont largement mobilisés : le “Fonds Friches” lancé en 2021 a bénéficié d’enveloppes significatives (300 M€, puis +350 M€ en 2021, +100 M€ en 2022) pour soutenir la reconversion des friches.
Ces financements attestent de la reconnaissance publique de l’enjeu mais également la nécessité de soutenir financièrement et de poursuivre cet effort.
Ainsi, cette phase d’évaluation n’est pas seulement un prérequis : c’est un acte stratégique majeur. En identifiant tôt les fonciers “actionnables”, en analysant leur potentiel (logements, activités, équipements), en arbitrant entre densification ou renaturation, les collectivités se doteront d’un réservoir d’opportunités foncières et d’une feuille de route opérationnelle. C’est dans cette ingénierie amont que réside la capacité à répondre aux tensions de marché du logement, à maîtriser les coûts fonciers et à faire du renouvellement urbain une réalité concrète et durable. Il est certain qu’une approche à la fois systémique et multiscalaire, qui se décline explicitement dans les documents de planification et d’urbanisme, constitue un prérequis indispensable. Nous sommes également convaincus que ce travail peut être réalisé à l’échelle d’un secteur ou d’un parc immobilier.
Les outils existent et doivent être utilisés ensemble :
• EPF d’État ou locaux : portage foncier, négociation, dépollution, recyclage opérationnel. Acteurs clés pour sécuriser la maîtrise foncière.
• ORT (Opérations de Revitalisation du Territoire) : simplification des procédures, dérogations PLU, mobilisation d’aides à la réhabilitation.
• DIIF / OPAH / OPAH-RU : dispositifs immobiliers et habitats spécifiques pour les logements anciens.
• Aides à la résorption des friches (ADEME, Fonds friches) : financements pour dépollution et requalification.
• Banque des Territoires / Action Logement : leviers financiers pour logements et équipements.
• Programmes ANRU : leviers majeurs dans les quartiers prioritaires (réhabilitation, nouveaux usages, espaces publics).
L’enjeu pour les collectivités : articuler ces outils autour d’une vision foncière claire.
Tous les retours d’expérience convergent : le pilotage foncier est l’ossature de la requalification. Ainsi la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dès cette phase est essentielle.
Sans maîtrise foncière :
• les projets sont bloqués,
• les prix explosent,
• les négociations s’enlisent,
• les programmations deviennent instables.
Avec maîtrise foncière :
• les calendriers se sécurisent,
• les usages s’ajustent,
• les charges foncières sont maîtrisées,
• les investisseurs peuvent s’engager,
• les ambitions environnementales sont maintenues ou dépassées,
• la programmation devient cohérente.
La requalification de friches n’est pas qu’un sujet urbain.
Le Cerema et l’ANCT montrent que les friches agricoles, artisanales, militaires ou industrielles sont nombreuses en ruralité et périphérie.
Elles permettent :
• de créer des services manquants (santé, commerce, tiers-lieux),
• de réinventer les mobilités actives (chemins, liaisons douces, cyclabilité),
• de diversifier les formes d’habitat,
• de reconstituer des centralités dans des zones dévitalisées,
• de limiter l’étalement résidentiel,
• de participer à la création de cellule économique prenant plus en compte les enjeux environnementaux et les nouveaux besoins.
Ces territoires disposent souvent de peu d’ingénierie locale, ce qui rend l’accompagnement extérieur déterminant pour définir les priorités, sécuriser les montages et garantir la viabilité des projets. Le rôle de Vizea s’inscrit pleinement dans cette dynamique, aux côtés des dispositifs de soutien départementaux et régionaux. À titre d’exemple, la mission que nous menons avec la Région Nouvelle-Aquitaine en appui aux territoires ruraux illustre cette démarche : apporter une ingénierie structurante pour aider les collectivités à concevoir des projets cohérents, opérationnels et alignés avec la feuille de route Néo Terra.
Nous avons la conviction que la complexité technique, réglementaire et opérationnelle des friches impose une ingénierie amont forte, capable d’embrasser simultanément les enjeux du sol, du climat, des usages et de la transformation urbaine. Souvent marquées par des sols pollués (métaux lourds, composés organiques persistants), des réseaux obsolètes, des nappes altérées ou une fragmentation écologique, les friches concentrent des enjeux environnementaux majeurs. Pourtant, ces contraintes constituent aussi un formidable levier d’action : déjà raccordées aux infrastructures urbaines, elles offrent une opportunité unique de recycler le foncier sans consommer de nouvelles terres agricoles ou naturelles. Leur reconversion peut même générer des bénéfices écologiques significatifs — restauration des sols, renaturation, infiltration des eaux pluviales, création d’îlots de fraîcheur, continuités écologiques — dans une logique de régénération environnementale essentielle à l’adaptation climatique. Les approches émergentes de sustainable remediation encouragent d’ailleurs des stratégies de dépollution bas-carbone, limitant l’énergie consommée et les volumes excavés.
Dans ce contexte, la reconversion des friches ne peut être efficace que si elle repose sur une connaissance précise des contraintes et des potentiels, et sur une vision globale du projet de territoire. Cette ingénierie doit ainsi mobiliser, de manière coordonnée :
• les sols, la pollution et les structures, pour qualifier les risques, évaluer les coûts de dépollution et sécuriser la constructibilité ;
• l’hydraulique et les risques naturels, notamment la gestion intégrée des eaux pluviales, la maîtrise des ruissellements et la résilience face aux inondations ;
• la biodiversité et les continuités écologiques, afin de transformer la friche en support de renaturation, de trames vertes et bleues, et de fonctionnalités écosystémiques ;
• l’eau, les microclimats locaux et la réaction bioclimatique de la morphologie urbaine, car la forme de la ville conditionne la manière dont elle capte, diffuse ou dissipe les flux de chaleur, de vent et d’humidité ;
• la qualité de l’air et la santé environnementale, avec une attention accrue aux expositions, nuisances, sols poussiéreux ou pollués, et aux populations vulnérables ;
• les usages, les pratiques et les attentes sociales, pour garantir que la requalification réponde aux besoins réels du territoire et renforce les solidarités locales ;
• la faisabilité économique, pour sécuriser les trajectoires financières et mobiliser les dispositifs d’aide ;
• l’analyse en coût global, afin de valoriser un urbanisme circulaire intégrant les coûts d’aménagement, d’entretien, de gestion des ressources, de résilience climatique et de fin de vie des matériaux, et démontrant la performance des stratégies de sobriété, de réemploi et de mutualisation ;
• le montage juridique et fiscal, indispensable pour maîtriser le foncier, structurer les partenariats et rendre le projet opérationnel.
Sur le terrain, nos équipes mobilisent une approche intégrée articulant expertise environnementale, ingénierie climatique, programmation urbaine, lecture fonctionnelle et évaluation des impacts. Cette combinaison de compétences permet d’appréhender les friches comme des systèmes complexes, où les dimensions écologique, sociale, technique et foncière interagissent étroitement. Dans la pratique, cette méthode facilite l’identification des leviers de transformation les plus pertinents et favorise des trajectoires de projet compatibles avec les objectifs de sobriété foncière, d’adaptation climatique et de revitalisation territoriale.
La requalification des friches ouvre également un potentiel considérable pour accélérer la transition bas carbone du secteur du bâtiment. En mobilisant l’existant plutôt qu’en construisant ex nihilo, elle permet d’éviter l’empreinte carbone majeure liée aux matériaux neufs, notamment le béton et l’acier. Mais au-delà de cette sobriété par l’usage du bâti existant, les friches constituent de véritables gisements de matériaux : structures métalliques, bois, éléments de façade, briques, blocs béton, pavés, voiries, réseaux, équipements réemployables. Ce « stock dormant » est souvent sous-estimé alors qu’il représente une ressource locale, immédiatement disponible et à faible impact environnemental.
Dans cette perspective, Vizea défend et met en œuvre un urbanisme résolument circulaire, qui vise à prolonger la vie des matériaux, réduire les déchets et limiter le recours à des ressources neuves. Lorsque cette logique est intégrée dès l’amont — inventaires matière, diagnostics ressources, activation des filières locales de réemploi — la friche devient un chantier exemplaire de décarbonation : moins d’extraction, moins de transport, moins de matière neuve, et une valorisation optimale du patrimoine existant. En révélant ces gisements et en les intégrant à la conception, la requalification contribue à un urbanisme plus sobre, cohérent avec les trajectoires bas carbone nationales, tout en renforçant les filières locales et l’ancrage territorial des projets.
La requalification des friches et le renouvellement urbain constituent aujourd’hui les leviers essentiels de la transformation durable des territoires. Ils permettent de répondre simultanément aux besoins pressants en logement, à l’exigence de sobriété foncière imposée par le ZAN, à la revitalisation des centralités, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des émissions carbones liées à nos modes de vie et à la réduction des inégalités territoriales. Mais ils sont également, et de manière croissante, des vecteurs d’action climatique et environnementale, capables d’ancrer la transition écologique dans des projets concrets, visibles et adaptés aux réalités locales.
En effet, les friches et les tissus urbains existants concentrent souvent des vulnérabilités environnementales : îlots de chaleur urbains, sols imperméabilisés, risques naturels, pollutions héritées, dégradation de la biodiversité. Leur transformation offre une opportunité rare d’y intégrer des solutions fondées sur la nature, une gestion de l’eau repensée, des continuités écologiques, et des stratégies de confort d’été adaptées aux épisodes de chaleur extrême. Les documents récents — en particulier les analyses de l’I4CE — rappellent que la France doit anticiper un climat 2050 potentiellement marqué par +3 à +4 °C de réchauffement moyen. Cette réalité impose d’intégrer l’adaptation non pas comme un supplément optionnel, mais comme un pilier structurant des projets.
Cela signifie :
• repenser les usages et les formes urbaines pour limiter les surchauffes et améliorer le confort ;
• intégrer systématiquement la gestion de l’eau à ciel ouvert et la lutte contre l’imperméabilisation ;
• prendre en compte la vulnérabilité sociale dans les choix d’aménagement ;
• mobiliser des matériaux, filières et méthodes moins carbonés ;
• étudier les réactions bioclimatiques de la morphologie urbaine et de ses transformations ;
• concevoir des quartiers capables d’absorber les aléas plutôt que de les subir.
Les besoins d’investissement identifiés par l’I4CE et les retours d’expérience de l’ANRU démontrent que les infrastructures existantes ne sont pas suffisamment adaptées et que les politiques publiques sous-estiment encore largement les coûts réels de l’adaptation. Dans ce contexte, la requalification des friches devient non seulement une réponse foncière, mais un outil majeur d’adaptation territoriale, au sens large : environnementale, climatique, sociale et économique.
En ce sens, nous sommes convaincus de l’importance de prendre en compte une démarche bioclimatique dans l’analyse des gisements et dans leurs exploitations. En effet, la morphologie urbaine et son évolution jouent un rôle direct dans :
• La captation ou la dissipation de chaleur (îlots de chaleur, albédo, inertie).
• La circulation de l’air (effet canyon, corridors de ventilation).
• La gestion de l'humidité et des apports solaires (ombrage, évapotranspiration).
• Le confort thermique en espace public comme dans le bâti.
Sur le plan économique, la requalification est souvent coûteuse – dépollution, démolition, études – et son modèle financier incertain. Elle exige des arbitrages éclairés entre valeur foncière, risques résiduels, soutenabilité des investissements et bénéfices pour le territoire. Enfin, la complexité de la gouvernance multi-acteurs rend indispensable une ingénierie forte : coordination des services publics, action des EPF, participation des habitants, sécurisation juridique. Dans ce contexte, la requalification des friches apparaît comme un révélateur des capacités des territoires à planifier, coopérer et investir collectivement dans leur propre transformation
Pour y parvenir, les collectivités ont besoin d’une ingénierie solide, capable de révéler les gisements, d’évaluer les risques et les opportunités, de maîtriser le foncier mobilisable, de bâtir des programmations cohérentes et de projeter un avenir possible et désirable. Elles ont également besoin d’un accompagnement pour intégrer ces enjeux dans leurs documents de planification, leurs stratégies ZAN, leurs feuilles de route environnementales et leurs choix d’investissement.
C’est précisément l’engagement et la contribution de Vizea : faire des friches de véritables ressources territoriales, activer les gisements fonciers latents, articuler les enjeux fonciers avec les enjeux climatiques, et contribuer à « refaire ville » de manière durable, cohérente et désirable. Dans la continuité de notre manifeste — rendre possible la transformation de notre société pour préserver la planète — nous avons pris une position claire : restreindre nos interventions en extension urbaine et orienter nos efforts vers la requalification des friches, des zones déjà urbanisées, levier majeur de sobriété foncière et de transition écologique.
Ce choix est assumé : il vise à préserver les sols vivants, la biodiversité et les continuités écologiques, à restaurer le cycle naturel de l’eau et à ménager les territoires. Il reflète également notre volonté de favoriser des valeurs locales et soutenables, en réinvestissant l’existant plutôt qu’en le consommant.
Notre approche systémique — qui associe ingénierie environnementale, expertise climat, programmation urbaine, démarche prospective et accompagnement stratégique — permet d’aider les territoires à anticiper les ruptures à venir, à renforcer leur résilience et à construire des lieux capables d’accueillir les usages et les modes de vie de demain. Dans cette logique, Vizea accompagne les collectivités dans l’identification des fonciers actionnables, leur hiérarchisation et leur mobilisation, afin de transformer un potentiel diffus en projets concrets, utiles et porteurs de sens.

Face aux attentes croissantes des consommateurs, investisseurs et collaborateurs, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est devenue un pilier fondamental pour une performance globale et durable. Aujourd’hui, les entreprises ne se contentent plus d’annoncer leurs engagements : elles souhaitent prouver, structurer et valoriser les actions menées à travers des certifications ou notations RSE. Mais comment s’y prendre concrètement ? Vers quels outils se tourner ? Quelles étapes suivre ?
Avant d’engager une démarche, il est essentiel de bien distinguer les différents dispositifs existants et de trouver le bon outil selon son entreprise, ses enjeux et objectifs.
Une norme est un document élaboré par un organisme reconnu (comme l’ISO, l’AFNOR, ou le CEN) qui fixe des principes, lignes directrices et bonnes pratiques à suivre dans un domaine précis.
Exemple : ISO 26000 est une norme internationale qui définit les lignes directrices de la responsabilité sociétale.
Elle n’est pas certifiable : une entreprise peut s’en inspirer pour structurer sa démarche, mais elle ne délivre pas de label ni de certificat.
Une certification atteste qu’une entreprise respecte les exigences d’une norme ou d’un référentiel donné, après un audit réalisé par un organisme tiers indépendant.
Exemple : une entreprise peut obtenir la certification ISO 14001 (management environnemental) ou ISO 9001 (qualité).
La certification est donc vérifiable et encadrée, ce qui lui donne une crédibilité externe.

Un label repose souvent sur un référentiel spécifique (parfois basé sur une norme) et valorise publiquement les entreprises engagées dans une démarche responsable.
Exemples : Label Lucie 26000, B Corp, Engagé RSE (AFNOR).
L’obtention d’un label est un outil de reconnaissance et de différenciation via une évaluation externe qui met l’accent sur la visibilité et la communication de l’engagement.

La notation RSE évalue le niveau de maturité et de performance d’une entreprise à partir de données documentées, selon des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Exemple : EcoVadis, qui attribue une note sur 100 et un niveau de médaille (bronze, argent, or, platine).
La notation n’aboutit pas à un label, mais à une évaluation comparative utile pour les appels d’offres, les investisseurs et les clients. C’est un outil de pilotage et d’amélioration continue, permettant de suivre ses progrès d’année en année.

Obtenir une certification ou améliorer sa notation demande du temps, une méthode ainsi qu’une bonne compréhension des référentiels. Vizea accompagne les entreprises de toutes tailles dans la structuration et la valorisation de leur démarche à travers un accompagnement RSE 360° :
Nous disposons de divers outils permettant un accompagnement adapté et précis en fonction des besoins et objectifs des entreprises.
Besoin d’un retour d’expérience pour vous lancer ?
Retrouvez le témoignage de l’entreprise Tecton qui a obtenu le niveau or pour sa première notation EcoVadis et prenez connaissance de notre livret d’initiation à la notation EcoVadis .

Les territoires disposent de leviers concrets pour mettre en place des solutions accessibles, efficaces et qui encouragent les modes alternatifs.
Avec le déploiement des Services Express Régionaux Métropolitains (SERM), cette réflexion gagne en urgence : comment faciliter l’interconnexion et le rabattement vers les PEM ?
Le SERM, dispositif de transport collectif pensé pour les grandes agglomérations, s’inspire du modèle des RER franciliens : desserte structurante, régulière, cadencée, connectant centres-villes, périphéries et zones périurbaines. Il offre une alternative crédible à la voiture individuelle.
Il s’inscrit dans une démarche de mobilité durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la cohésion territoriale, en facilitant l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements. Les PEM, véritables portes d’entrée du réseau SERM, doivent être conçus comme des catalyseurs d’intermodalité : correspondances fluides, sûres, décarbonées.
Penser les PEM à l’aune du SERM, c’est repenser la façon d’accéder au réseau : favoriser les mobilités actives, diminuer la dépendance à la voiture et transformer les déplacements du quotidien en leviers de transformation territoriale.
L’intermodalité désigne le fait, pour une personne ou une marchandise, d’utiliser plusieurs modes de déplacements similaires ou différents lors d’un déplacement (à partir de deux trajets). Afin d’interroger les enjeux de l’intermodalité au sein des PEM, il convient de caractériser celle-ci, en prenant l’exemple des grands mobiles intermodaux. Ils se définissent comme des personnes faisant au moins un déplacement de plus de 10 km par jour. Cette notion est issue de l’ouvrage bilan du Cerema « MOBILITÉS :Comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain ». Les résultats des enquêtes ménages et déplacements dites EMC² sur des métropoles (dont certaines sont aujourd’hui concernées par un SERM) dressent le constat d’une augmentation de la part grands mobiles intermodaux au sein des usagers pratiquant l’intermodalité
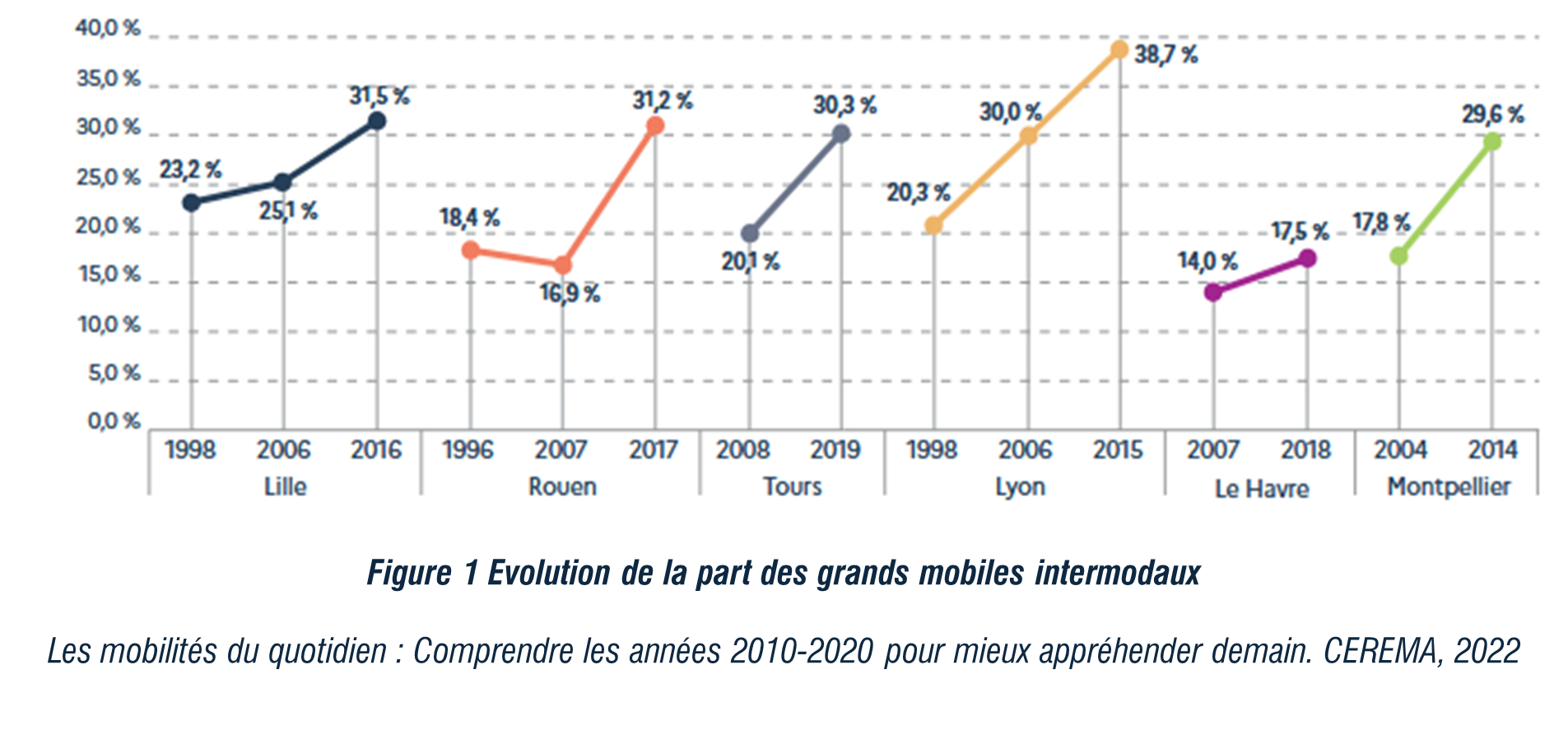
Cette augmentation est liée au phénomène de périurbanisation et de retour vers le ‘rural’ d’une partie de la population des grandes métropoles ainsi que la concentration de l’emploi, des services dans les pôles d’activités (situé dans les espaces urbains), allongeant de ce fait les distances parcourues pour les déplacements quotidiens. Entre 1999 et 2019, la distance médiane des déplacements domicile-travail a augmenté de 4,4 km pour les actifs en emploi résidant dans le rural (contre 2,3 km pour l’ensemble des actifs en emploi) avec une distance pour un aller de 12.5 km pour des habitants du rural contre 6 km pour les urbains.
Concernant leurs modes de déplacements, 54% des grands mobiles intermodaux favorisent l’intermodalité avec leur véhicule personnel pour se rendre vers un transport en commun contre 28% pour autres usagers intermodaux. De plus, il y a une grande différence entre les grands mobiles intermodaux et les autres personnes pour l’intermodalité TC-TC. Ils sont selon 35% pour les grands mobiles intermodaux contre 66% pour les autres usagers. Cet écart s’explique, par la localisation des grands mobiles intermodaux. Ils vivent majoritairement en périphérie des métropoles, où le recours à la voiture est prépondérant du fait de l’offre de TC moindre pour rejoindre les PEM en termes de cadence, d’amplitude horaire et de desserte.
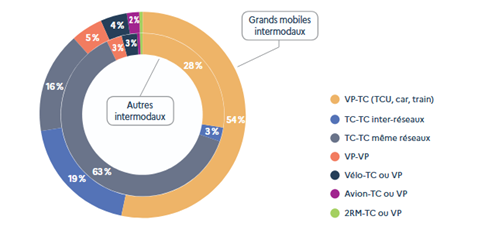
Image 2 : Comparaisons des combinaisons intermodales des grands mobiles avec celles des autres personnes.
Les mobilités du quotidien : Comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain. CEREMA, 2022
Ces données montrent l’importance du recours à l’automobile dans les trajets intermodaux et des enjeux de l’accueil de celle-ci au sein des PEM pour le stationnement. L’aire d’attractivité des PEM desservis par un SERM étant élargie, l’importance du recours à la voiture augmente en concordance.
Le stationnement est une problématique centrale aujourd’hui dans l’aménagement des pôles d’échanges. Dans de nombreuses intercommunalités, la demande en stationnement au niveau des PEM dépasse souvent la capacité des parkings relais, notamment aux heures de pointe, ce qui crée des tensions (stationnement sauvage, conflits d’usage, congestion locale). Ce phénomène, particulièrement accentué dans le périurbain et dans le rural (on retrouve ici les zones que souhaite cibler les SERM) est multifactoriel :
La réalisation des SERM, induisant une amélioration d’offre de transport, a renforcé l’attractivité et la zone de rabattement de gare qui ont dû se redimensionner en PEM. Cela a conduit les collectivités à réaliser des travaux en créant notamment des extensions de parking. Plusieurs exemples ont été présentée lors des webinaires du Cerema lié à l’aménagement des PEM avec l’arrivée du SERM :
Bien qu’utiles ces aménagements entrainent leurs lots de conséquences :
Ces projets d’extensions questionnent sur la cohérence des politiques de mobilité. En effet le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle reste un enjeu majeur, afin de réduire les émissions de GES et offrir des solutions de mobilité crédibles pour tous les habitants. Ils témoignent cependant de l’importance actuelle de l’intermodalité à partir de la voiture pour rejoindre les PEM périurbain. Un paradoxe quand l’un des principes même du SERM est de décarboné les mobilités et de les rendre accessibles à tous.
A partir de ce constat, quelles sont les solutions envisageables (et d’ores et déjà envisagées par les territoires) afin de résoudre les problématiques de stationnement et de briser l’engrenage de l’extension des espaces de stationnement ?
Les solutions liées à l’aménagement des PEM sont réparties en deux catégories : celles limitant l’attractivité de la voiture et celles permettant de développer l’intermodalité grâce aux modes doux
• Stationnement payant ou à durée limitée : introduction d’une tarification progressive pour décourager le stationnement longue durée.
• Tarification différenciée selon l’usage : tarifs réduits pour les covoitureurs, véhicules partagés ou électriques.
• Abonnement réservé aux usagers des transports : contrôle d’accès via billet de transport, carte du réseau de TC, QR code SNCF par exemple.
• Réserver des espaces de stationnement aux usagers du covoiturage : contrôle par barrières, QR code ou lecture de plaque :
• Zones à durée maximale stricte : rotation obligatoire, voire verbalisation automatisée
• Refuser l’agrandissement des parkings pour inciter à un report modal
• Extensions durables en utilisant de revêtements perméables (dalles engazonnées, graviers stabilisés), l’aménagement de parking silo en matériaux biosourcés, implantation d’ombrières photovoltaïques.
Le gare d’Ambérieu du réseau SERM Lyonnais, étant dans sa phase réaménagement en PEM, est en réflexion sur une tarification différenciée pour chacun des espaces de stationnement prévu avec un parking de covoiturage gratuit, un parking payant, 10 places de dépose minute et enfin le futur parking relais.

Exemple avec l’extension de stationnement en projet à Ambérieu en utilisant une structure de parking à étages démontable en Bois scolyté.

Image 4 : Projet de Parking Relais durable sur le PEM d'Ambérieu
Source : Communauté de communes de la Plaine de l’Ain présentation webinaire CEREMA
Enfin la gestion dynamique du stationnement peut aider à limiter les désagréments engendrés par l’usage excessif de la voiture. En effet, la plupart des PEM périurbains arborent encore avec une gestion passive du stationnement avec, notamment, une absence de suivi en temps réel, un manque d’information sur les disponibilités en stationnement, ainsi qu’une absence de pilotage coordonné avec les autres modes de transport. Cela peut entrainer de la circulation inutile afin de trouver une place. La gestion dynamique s’appuie sur des systèmes de comptage en temps réel permis par des capteurs qui peuvent ensuite être relayés par un système d’information dynamique : les informations sur le nombre de places disponibles et leur localisation. Un système de réservation peut être mis en place que ce soit via l’abonnement de transport ou avec un lecteur de plaque, les réservations pouvant être différenciées selon les types de déplacement (favorisant l’écomobilité par exemple). Ce système permet également d’analyser et d’améliorer la gestion du stationnement via la collecte des données d’occupation pour identifier les heures de pointe, les profils d’usagers, les types de déplacements.
D’autres aménagements peuvent être réalisées pour favoriser la fluidité de la circulation au sein des PEM, la création de zones « dépose-minute » situées proche de la gare (limitant la durée de stationnement et favorisant les arrivées en covoiturage) est l’exemple le plus commun. Par exemple le PEM de Belleville-en-Beaujolais intégré dans le SERM Lyonnais qui plutôt que d’agrandir ces espaces de stationnement à préférer opter pour la mise en gestion de plusieurs zones de stationnement afin de privilégier certains usagers (covoiturage, habitants en fonction de l’éloignement de la gare) permettant aussi une souplesse d’évolution dans le temps.
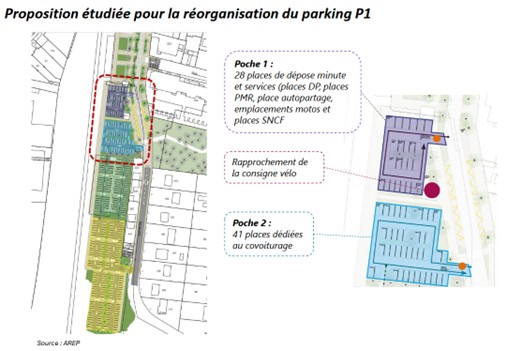
Image 5 : plan de la répartition des zones de stationnement du PEM de Bellevile-en-Beaujolais
Source : AREP/CC de Saône en Beaujolais, webinaire Cerema
Aménagements pour les piétons :
Des aménagements et des services à destination des piétons sont indispensables afin d’inciter leur pratique, ce travail est à réaliser aux abords du PEM mais également à une échelle plus large.
Parmi les aménagements pour les piétons, on peut citer les cheminements sécurisés, continus et lisibles : trottoirs larges, éclairage, traversées courtes et sécurisées (plateaux ralentisseurs par exemple), revêtements confortables, abris pluie/soleil. Il faut également veillez à ce que ces aménagements soient accessibles pour les PMR (avec des mises à niveau, des revêtements spécifiques, des ascenseurs ou rampes PMR)
Dans l’enceinte du PEM la priorité de circulation doit être piétonne, en réduisant les vitesses de circulation, en aménageant des traversées surélevées et des marquages lisibles. Les espaces publics du PEM et alentours doivent être agréables à fréquenter avec des espaces d’attente, de charge d’appareils informatiques, de travail, de végétalisation ainsi qu’une signalétique intuitive. Le PEM de Rennes est un bon exemple de cette prise en compte du piéton avec sa passerelle piétons sécurisée, la continuité des trottoirs vers les commerces et ces espaces de travail.

Image 6 : PEM de la Gare de Rennes Métropole
Source : SNCF Gares Et Connexions -AREP / Photographe : Mathieu Lee Vigneau
Aménagements pour les cyclistes :
Favoriser l’intermodalité cycles/TC dans les PEM passe également par l’aménagement de voie cyclables et par l’implantation de plusieurs services en gare et aux alentours.
Le premier axe est l’aménagement de cheminements cyclables continus et sécurisés, par le biais de pistes, voies vertes ou bandes cyclables selon le trafic, les vitesses de circulation observées et les largeurs disponibles. Le raccordement de ces installations à des itinéraires cyclables existants permettent d’assurer une continuité des déplacements depuis les pôles générateurs de flux vers les PEM. La signalétique vélo sur le trajet et au sein du PEM est également primordiale afin de guider les cyclistes jusqu’aux équipements et services vélo. De nombreux territoires travaillent dans ce sens. C’est le cas notamment du PEM de Brignoud (CC Grésivaudan, futur SERM Grenoblois). Les travaux prévoient des aménagements cyclables raccordés au PEM avec une voie verte de 4 mètres (mise en service prévue en 2028). C’est aussi le cas pour le SERM de Montpellier avec l’aménagement d’uune voie verte entre Lunel et Marseillargues sur 3.7 km en 2021.


Images 7 & 8 : Voie verte Lunel – Marsillargues (Schéma et Photographie)
Source : Lunel Agglomération
En plus des aménagements d’autres services doivent être mis en place pour favoriser l’usage du vélo :
• Stationnements vélos sécurisés et couverts avec recharge VAE, permettant aux cyclistes de garer leur vélo rapidement et de façon sécurisée. Ces dispositifs favorisent l’intermodalité en réduisant la crainte du vol ou du vandalisme et en offrant une solution rapide de stationnement,
• Ateliers vélo ou services de réparation/gonflage rapide sur site. Permet l’entretien de base des vélos (crevaison, réglages…). Cela favorise la fiabilité du vélo comme mode de déplacement quotidien
• Des casiers sécurisés pour stocker ses affaires (équipement vélo, vêtement de pluie) améliorant le confort de cycliste
Le PEM de la gare Nantes est un modèle concernant les services vélo avec un format d’abonnement permettant l’accès à 1216 places de stationnement adaptés pour les vélos électriques avec des bornes de recharge, les vélo Cargos et longtails via des emplacements grand format, des stationnement adaptés PMR. Concernant les autres services, l’espace dispose de casiers pourvus de prises électriques ainsi qu’un atelier de réparation.


Images 9 & 10 : Services vélo du PEM de Nantes Métropole
Photographe Léo Hureau
Dans les PEM de grande importante il est déterminant d’installation d’un système de vélo en libre-service et sur plusieurs pôles clés du territoire comme à Saint-Malo avec le réseau Vélo MAT avec des VLS en gare, aux arrêts de transport en commun (Car, TAD).

Image11 Emplacement de stationnement des vélos en libre-service au PEM de Saint-Malo
Source : Ville de Saint-Malo
Ces aménagements et services encouragent, sécurisent et rendent légitime l’usage du vélo pour les trajets vers le PEM.
Aménagements pour les transports en commun :
L’attractivité des transports en commun moindre dans les espaces ruraux et périurbain est principalement imputable au cadencement et à l’amplitude horaire de ces services dans ces espaces, représentant un coût d’exploitation trop important pour les collectivités au vu du nombre d’usagers. Dans les cadres des PEM rattachés à un SERM, il est essentiel d’harmoniser la cadence et l’amplitude horaire des bus avec celle du SERM afin de faciliter les correspondances. Pour les communes les plus denses la création de lignes de rabattement fréquentes et directes via un bus express ou car à haut niveau de service (BHNS) est préconisée. Le transport à la demande est quant à lui plus favorable sur des territoires ruraux où la fréquentation des lignes de transports traditionnelles est plus faible au regard du coup qu’elles représentent.
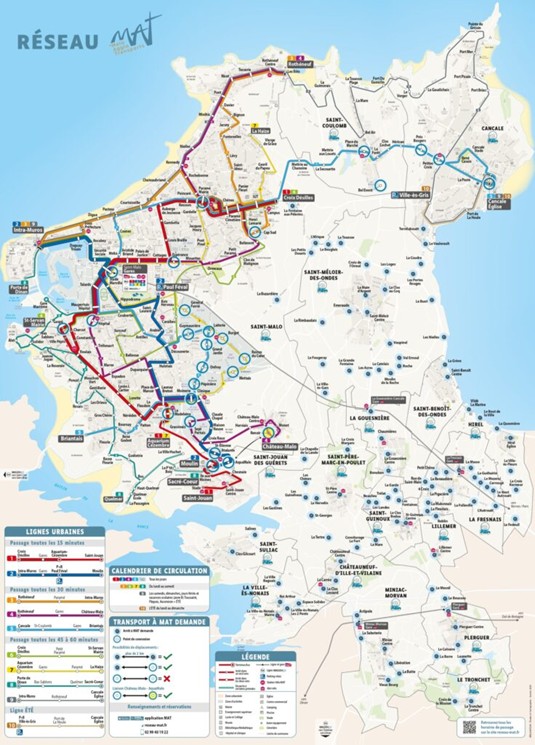
Image 12 : Carte du nouveau réseau MAT (janvier 2025)
Source : Saint-Malo Agglomération
Le BHNS de Nantes, desservant un arrêt à proximité de la gare et du tram ainsi que le BHNS d’Aix-en-Provence desservant lui aussi la gare (s’intégrant dans la futur SERM Aix Marseille Provence 2030) sont deux exemples d’une intégration d’un BHNS connectant un PEM desservi par un SERM. Concernant le transport à la demande, l’agglomération de Saint-Malo a fait le choix de convertir une partie de son réseau de ligne continue en arrêt de transport à la demande ainsi que de créer des nouveaux arrêts de TAD pour mailler plus équitablement le territoire et offrir une alternative à la voiture dans les territoires les plus enclavés (arrêt de TAD en bleu sur la carte).
Enfin, un travail peut également être réalisé sur la tarification avec la mise en place d’une billettique unique ou de carte d’abonnement réseau. La Communication et lisibilité de l’offre sur une application unique, en temps réel mais aussi au niveau du PEM avec des arrêts et des noms de lignes établis (les changements d’exploitants ou d’échelle pour le réseau entrainant parfois des changement s de nom et donc de la confusion) est primordiale.
Le recours à la voiture dans les pratiques intermodales, notamment celles de longues distances est toujours importante voire en augmentation.
Les enjeux d’aménagements lié à l’intermodalité voitures sont un produit du système voiture national poussé par les politiques de mobilité depuis plusieurs décennies. Les solutions pour diminuer son influence passent par l’encadrement de cette pratique: l’intermodalité voiture est obligatoire pour certaines personnes mais il faut viser à ce qu’elle ne soit pas la solution majoritaire.
Le développement modes doux au sein des PEM et d’autant plus intéressant dans le cadre du SERM qui visent un cadencement régulier ainsi qu’une sobriété des déplacements. La diminution de l’intermodalité voiture/SERM et TC en général au profit de l’intermodalité modes doux/SERM et TC a des conséquences au- delà des PEM : sur les écosystèmes avec la moindre artificialisation pour des places de stationnement dans le contexte de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Pour les habitants avec moins de nuisances sonores, atmosphérique, une meilleure qualité paysagère et enfin la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique.
EXPERTISES TERRITOIRES : WEBINAIRE SERM :
WEBINAIRE DU 13 JUIN 2025 : COMMENT ANTICIPER L’ARRIVEE D’UN SERM SUR MON TERRITOIRE
WEBINAIRES DU 19 SEPTEMBRE 2025 : LA PLACE DE LA VOITURE DANS LES PEM DES SERM
https://www.expertises-territoires.fr/jcms/pl1_530939/fr/services-express-regionaux-metropolitains-serm
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/services-express-regionaux-metropolitains-serm
PUBLICATIONS :
CYPRIEN RICHER - L'EMERGENCE DE LA NOTION DE "POLE D'ECHANGES" : ENTRE INTERCONNEXION DES RESEAUX ET STRUCTURATION DES TERRITOIRES CST:12075 - LES CAHIERS SCIENTIFIQUES DU TRANSPORT - SCIENTIFIC PAPERS IN TRANSPORTATION, 30 NOVEMBRE 2008, 54 | 2008 - HTTPS://DOI.ORG/10.46298/CST.12075
CYPRIEN RICHER, GILLES BENTAYOU, BERTRAND DEPIGNY. LES POLES D’ECHANGES, DE LA GESTION DE L’INTERMODALITE AUX NOUVEAUX ENJEUX POUR L’ESPACE PUBLIC. TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES & MOBILITE, 2018
BURCIN YILMAZER, CYPRIEN RICHER. DEMARCHES INNOVANTES D’INTERMODALITE, DE HUBS ET POLES D’ECHANGES DANS LES TERRITOIRES PEU DENSES. RAPPORT DE RECHERCHE DU
PROJET TELLI – TRAIN LEGER INNOVANT, LIVRABLE L1.2.1, CEREMA; SNCF; RAILENIUM; FERROCAMPUS. 2025
LISA ANDRE :LA PERTINENCE DES POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX PERIPHERIQUES POUR LES USAGERS FACE A L’EVOLUTION DE L’ACCUEIL DES DIFFERENTS SERVICES DE CARS INTERURBAINS LE CAS DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE – JUIN 2018 MEMOIRE DE MASTER 1 – UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
Page 1 sur 51
