Energie/EnR - Zonage de l’éolien offshore français
- Création : 16 septembre 2010
La définition de ces zones a tenu compte de plusieurs critères tels que :
- le potentiel éolien,
- la présence de zones naturelles sensibles,
- les zones de pêche,
- les voies maritimes commerciales.
Certaines voix s'élèvent déjà du côté des professionnels, inquiets pour les projets en cours. En effet, certains parcs offshore actuellement à l’étude pourraient ne pas être localisés dans les zones déterminées par ces concertations.
Urbanisme durable - De nouveaux éléments pour l’élaboration de la Trame verte et bleue
- Création : 15 septembre 2010
- le premier, à l’attention des décideurs, présente les fonctions et enjeux de la Trame verte et bleue et les 10 grands choix stratégiques pour sa mise en œuvre ;
- le second est destiné aux services de l’Etat et aux régions, qui auront notamment à piloter l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (Ces schémas SRCE, qui doivent être élaborés avant fin 2012, contiennent notamment les mesures contractuelles permettant la préservation ou la remise en état des continuités écologiques.). Ce guide présente notamment des recommandations méthodologiques pour l’élaboration de la Trame verte et bleue en région et analyse les aspects socioéconomiques associés ;
- le troisième s’adresse aux gestionnaires d’infrastructures linéaires de transport de l'État.
La Trame verte et bleue prend en compte la capacité de dispersion des espèces sur des échelles de territoire différentes pour constituer un maillage de continuités écologiques. La bonne articulation des niveaux d’intervention (national, régional et local) est ainsi fondamentale pour garantir la pertinence de cette démarche. Il est donc nécessaire que les enjeux et orientations soient relayés à toutes les échelles par l’intermédiaire de différents documents de planification (orientations nationales / schémas régionaux (SRCE) / SCOT / PLU / documents encadrant les projets d’aménagement).
Energie - Lancement du troisième appel à projets BCIAT 2011 de l'ADEME
- Création : 13 septembre 2010
Après avoir déjà lancé deux appels à projets en 2008 et 2009 dans le but de développer la filière de production de chaleur à partir de biomasse dans les secteurs de l’industrie, l’agriculture et le tertiaire, l’ADEME vient de lancer, le jeudi 9 septembre 2010, un troisième appel à projets intitulé « Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire (BCIAT 2011) ». Pour rappel, ces appels à projets lancés par l'ADEME sont partie intégrante du Fonds Chaleur Renouvelable destiné à promouvoir les énergies renouvelables dans le système énergétique français afin d'atteindre l'objectif de 23% à l’horizon 2020. Doté d'environ un milliard d’euros sur trois ans (2009 - 2011), le Fonds Chaleur fait partie des cinquante mesures mises en place dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Comme le précédent (BCIAT 2010), ce nouvel appel à projets porte sur la réalisation d'installations industrielles assurant une production énergétique annuelle supérieure à 1 000 tonnes équivalent pétrole (tep) à partir de biomasse. L'objectif visé à travers cet appel à projets est d’atteindre un bilan total de 175 000 tep/an.
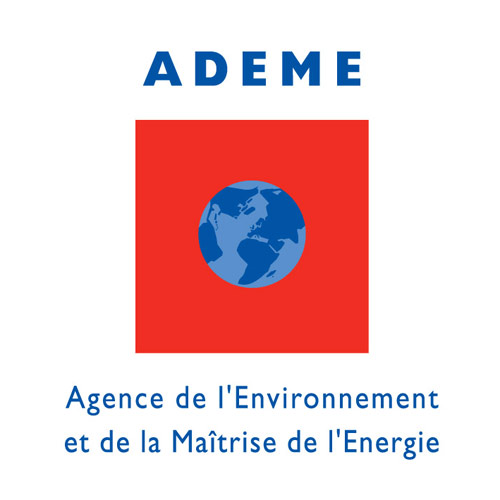 La phase d’appel à candidatures se déroulera du 8 septembre 2010 au 1er février 2011. L’analyse, la mise en concurrence et la sélection des projets aboutira à la diffusion des résultats et à la notification des propositions d’aides au mois de Juillet 2011. Il est à noter que les installations retenues devront être mises en service avant le 1er août 2013.
La phase d’appel à candidatures se déroulera du 8 septembre 2010 au 1er février 2011. L’analyse, la mise en concurrence et la sélection des projets aboutira à la diffusion des résultats et à la notification des propositions d’aides au mois de Juillet 2011. Il est à noter que les installations retenues devront être mises en service avant le 1er août 2013.
En plus de la mise en place de ce nouvel appel à projets, l’ADEME à également annoncé que le bilan actualisé du BCIA 2009 ainsi que les résultats de l’appel à projets BCIAT 2010 seront en ligne à partir du 2 octobre 2010 sur son site Internet.
- Plan d’approvisionnement en préfectures : 1er février 2011
- Dossier de candidature complet à l’ADEME : 1er février 2011
- Avis des préfets de région aux candidats : 31 mars 2011
- Copie de l’avis du préfet de région à l’ADEME : 15 avril 2011
Urbanisme Durable - Des conteneurs recyclés en logements modulaires
- Création : 8 septembre 2010
Formule importée des Pays-Bas, où l’idée est née suite aux difficultés d’hébergement rencontrés par les étudiants, la construction de ces logements modulaires assure une seconde vie aux conteneurs anciennement utilisés pour le transport maritime des marchandises et se veut une réponse à la pénurie du logement étudiant en France.
Les conteneurs sont disposés autour d’un patio sur une ossature métallique de quatre niveaux, avec de larges baies vitrées découpées dans la tôle. La structure métallique qui porte les conteneurs a permis de décaler les studios et d’implanter passerelles, balcons et terrasses. Les cent logements répartis sur quatre niveaux à partir d’un rez-de-chaussée surélevé, entourent ainsi un jardin intérieur.
Ainsi, si cette solution pourrait constituer une des pistes pour résoudre la pénurie de logements universitaires en France, le retour d’expérience d’un tel projet est attendu. Il est en effet nécessaire de s’interroger notamment sur la perception des usagers en termes de confort et de fonctionnalités, mais aussi sur le bilan des consommations énergétiques (le bâtiment est annoncé THPE), la durée de vie et la fin de vie de ce type de bâtiment ainsi que son bilan environnemental global.
Environnement - Utilisation des eaux usées traitées désormais autorisée
- Création : 6 septembre 2010
Les règles de mises en œuvre, d’utilisation des eaux usées traitées, de suivis et de programmes de surveillance pour la qualité des sols et de l’eau, des distances à respecter vis-à-vis de certaines activités protégées sont dorénavant cadrées. En France, l’agriculture ainsi que les centrales thermiques et nucléaires sont les plus gros consommateurs d’eau, viennent ensuite l’industrie et les consommations municipales / domestiques à moindre échelle.
L’objectif d’une législation sur l’utilisation de ces eaux usées traitées en agriculture est d’éviter tout risque de pollution dans le milieu naturel et de garantir la protection de la santé publique et animale. L’eau est une ressource vitale et la prise de conscience mondiale pousse de plus en plus les pays développés à se responsabiliser devant les problématiques de sécheresse, de croissance de population et d’équilibre du cycle naturel de l’eau.
Après vingt ans de rapports et de dialogues entre les différents organismes et Ministères responsables de la Santé, de l’Agriculture et du Développement Durable, la France rattrape enfin son retard. En effet, les Etats-Unis recyclent leurs eaux usées pour l’agriculture depuis plus de trente ans (34% en Floride et 63% en Californie). La Tunisie, l’Espagne, Chypre, le Japon, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Australie sont également exemplaires sur cette question de recyclage.
Cette nouvelle possibilité de raccordement aux eaux issues du traitement d’épuration doit permettre d’offrir plus d’autonomie en eau à l’échelle d’un pays tout en apportant une ressource alternative à faible coût.



